Pour Jean-Baptiste
Il est temps de parler enfin de choses un peu intelligentes sur ces pages, sous peine terminer l'année sur des futilités innocentes. Je tente donc une audacieuse réflexion rapprochant les deux romans dernièrement lus et aimés, rapprochement qui pourra sembler improbable tant Antoine Bloyé et son auteur révolté Paul Nizan ont peu à voir avec l'aristocrate désabusé Tomasi di Lampedusa, père du Guépard.
Improbable, certainement; malgré tout ces deux livres ont le trait commun de mettre en scène des hommes en prise avec leur classe sociale, qui subissent à la fois le poids du passé et les bouleversements d'un monde en pleine mutation. Personnages qui peuvent nous aider à réfléchir sur l'identification d'un individu à sa classe. Entre le prince Fabrizio, l'aristocrate qui constate avec lucidité la décadence de sa lignée et du monde qui l'a portée, et l'ingénieur embourgeoisé, Antoine, arraché à la condition ouvrière par un ascenseur social plus subi que choisi, le jeu de miroir est troublant.
Il est temps de parler enfin de choses un peu intelligentes sur ces pages, sous peine terminer l'année sur des futilités innocentes. Je tente donc une audacieuse réflexion rapprochant les deux romans dernièrement lus et aimés, rapprochement qui pourra sembler improbable tant Antoine Bloyé et son auteur révolté Paul Nizan ont peu à voir avec l'aristocrate désabusé Tomasi di Lampedusa, père du Guépard.
Improbable, certainement; malgré tout ces deux livres ont le trait commun de mettre en scène des hommes en prise avec leur classe sociale, qui subissent à la fois le poids du passé et les bouleversements d'un monde en pleine mutation. Personnages qui peuvent nous aider à réfléchir sur l'identification d'un individu à sa classe. Entre le prince Fabrizio, l'aristocrate qui constate avec lucidité la décadence de sa lignée et du monde qui l'a portée, et l'ingénieur embourgeoisé, Antoine, arraché à la condition ouvrière par un ascenseur social plus subi que choisi, le jeu de miroir est troublant.
 Les deux livres se prêtent à cet exercice, étant axés sur la vie de leur personnage principal qui est aussi le point de focalisation de la narration - et qui porte le titre de l'ouvrage. Ils déploient le même cadre historique, celui d'une montée en puissance de la bourgeoisie, incarnée par le personnage de don Calogero dans le Guépard, qui se manifeste pleinement lors d'une scène théatrale:
Les deux livres se prêtent à cet exercice, étant axés sur la vie de leur personnage principal qui est aussi le point de focalisation de la narration - et qui porte le titre de l'ouvrage. Ils déploient le même cadre historique, celui d'une montée en puissance de la bourgeoisie, incarnée par le personnage de don Calogero dans le Guépard, qui se manifeste pleinement lors d'une scène théatrale:"Le Prince avait toujours tenu à ce que le premier dîner à Donnafugata [son fief] eût un caractère solennel [...] Il ne transigeait que sur un détail: il ne mettait pas d'habit de soirée pour ne pas embarrasser ses hôtes qui, évidemment, n'en possédaient pas. Ce soir-là, dans le salon dit "de Leopoldo", la famille Salina attendait les derniers invités [...] Tout était paisible et comme à l'accoutumée, lorsque Francesco Paolo, le fils de 16 ans, fit une irruption scandaleuse dans le salon: "Papa, don Calogero est en train de monter l'escalier. Il est en frac!"L'écroulement du monde du Prince, politiquement marqué par le fameux débarquement de Garibaldi sur les côtes siciliennes, s'incarne dans ce parvenu ridicule - à la fille duquel il mariera pourtant son neveu chéri, Tancredi au nom si héroïque! La saveur inimitable de cette description tient peut-être à l'amertume explicite de Lampedusa, l'aristocrate, devant l'accession au pouvoir, par le biais de la république, d'une classe aussi piètrement symbolisée. Le Guépard est l'héritier d'une lignée, d'un monde qui vont disparaître avec lui: et il n'en est que trop conscient. Le Prince, relayé par le narrateur, contemple avec un regard féroce les filles de l'aristocratie sicilienne, écrasées par la beauté d'Angelica, la fille de don Calogero, fiancée de Tancredi:
Tancredi évalua l'importance de la nouvelle une seconde avant les autres; il était occupé à ensorceler la femme de don Onofrio, mais quand il entendit le mot fatal, il ne put se retenir et éclata d'un rire convulsif. Le Prince au contraire ne rit pas, lui à qui, il faut le dire, la nouvelle fit plus d'effet que le bulletin du débarquement à Marsala. Ce dernier avait été non seulement un évènement prévu, mais aussi lointain et invisible. A présent, sensible comme il l'était aux présages et aux symboles, il contemplait la Révolution en personne dans ce noeud papillon et cette queue-de-pie noire qui montaient l'escalier de sa maison. Non seulement, lui, le Prince, avait cessé d'être le plus grand propriétaire de Donnafugata, mais il se voyait aussi contraint de reçevoir en costume d'après-midi un invité qui se présentait, à bon droit, en habit de soirée.
Son abattement fut grand et durait encore tandis qu'il avançait mécaniquement vers la porte pour reçevoir l'invité. Mais quand il le vit, ses souffrances furent plutôt allégées. Parfaitement adéquat en tant que manifestation politique, on pouvait cependant affirmer que, quand à la réussite de sa confection, le frac de don Calogero était une catastrophe. Le tissu était très fin, le modèle récent, mais la coupe était tout simplement monstrueuse. Le Verbe londonien s'était très maladroitement incarné en un artisan de Girgenti auquel l'avarice tenace de don Calogero s'était adressée. Les pointes des deux pans se relevaient vers le ciel en une supplication muette, le grand col était informe et, quoique ce soit pénible, il faut bien le dire, les pieds du maire étaient chaussés de petites bottes à boutons."Le Guépard, II, p. 80-81 (c'est moi qui souligne)
"Mais les autres... heureusement que des tenèbres de Donnafugata avait émergé Angelica pour montrer aux Palermitaines ce qu'était une belle femme.Il y a quelque chose de morbide dans cette classe décadente, que la vitalité sans scrupules et sans éducation d'Angelica vient balayer d'un revers de main gantée. Mais il faut absolument lire le dernier chapitre du roman pour lire l'histoire des propres filles du Prince...
On ne pouvait pas lui donner tort: dans ces années-là, la fréquence des mariages entre cousins, dictés par la paresse sexuelle et les calculs terriens, la rareté de protéines dans l'alimentation aggravée par l'abondance d'amidon, le manque total d'air frais et de mouvement, avaient remplis les salons d'une foule de jeunes filles incroyablement petites, invraisemblablement olivâtres, insupportablement gazouillantes; elles passaient leur temps coagulées entre elles, ne lançant des appels en choeur aux jeunes hommes apeurés, destinées, semblait-il, à ne servir que de toiles de fond aux trois ou quatre belles créatures qui [...] passaient en glissant comme des cygnes sur un étang rempli de grenouilles. Plus il les voyait plus il se sentait irrité; son esprit habitué aux longues solitudes et aux pensées abstraites finit par lui procurer, à un moment donné, une sorte d'hallucination alors qu'il traversait une longue galerie en passant devant un pouf* central où s'était rassemblée une colonie de ces créatures: il lui semblait être le gardien d'un jardin zoologique en train de surveiller une centaine de jeunes guenons: il s'attendait à les voir tout d'un coup grimper aux lustres, et là, suspendues par la queue, ses balancer en exhibant leur derrière et en lançant des coquilles de noisettes, des cris et des grincements de dents sur les pacifiques visiteurs.
Etrangement, ce fut une sensation religieuse qui le détourna de sa vision zoologique: en effet, de ce groupe de guenons en crinolines, s'élevait, monotone et continue, une invocation sacrée: "Marie! Marie!", s'exclamaient perpétuellement ces pauvres filles [...] Le nom de la Vierge, invoqué par ce choeur virginal, remplissait la galerie et changeait de nouveau les guenons en femmes, parce qu'il ne semblait pas encore que les ouistitis* des forêts brésiliennes se soient converties au Catholicisime"Le Guépard, VI, p. 234-235 (c'est moi qui souligne)

Au long d'Antoine Bloyé, l'image de la bourgeoisie est celle d'un idéal proposé à ce fils d'ouvrier dont on fait par la force de l'école républicaines, pour les besoins de la nation en techniciens obéissants, un ingénieur.
"Tout encourageait alors la jeunesse ouvrière, les descendants ambitieux des artisans, des petits fonctionnaires, à entrer dans le complot du commandement; Antoine y avait été entraîné comme les autres et il ignorait tout des ressorts qui tendaient cette grande entreprise, il ne savait pas qu'il faisait avec bien d'autres adolescents de son âge un des enjeux de la vaste partie que commençaient à engager les principaux maîtres de la bourgeoisie française. On lui avait dit simplement qu'il pourrait échapper à la misère, aux incertitudes ouvrières, et ces promesses avaient trop bien répondu aux tentations que sa ville lui offrait pour qu'il se refusât à les entendre. Il ne savait rien"Parvenu, Antoine Bloyé ne parvient pas à surmonter la contradiction interne qui l'habite entre la conscience d'une trahison envers sa classe et l'impossibilité de se reconnaître dans la bourgeoisie:Antoine Bloyé, V, p. 68 (c'est moi qui souligne)
"C'étaient des hommes prêts à tuer des ouvriers. Antoine les détestait, mais il leur donnait des conseils pour briser sans violences la grève des ouvriers. Je suis mon propre ennemi, se disait-il. Cette division de lui-même, ce déchirement de sa vie, cet abîme qui séparait sa jeunesse de son âge mûr, ce malheur éclataient dans ces conciliabules avec les policiers"A l'inverse de Fabrizio Salina, trop enraciné, chargé de trop d'histoire, Antoine est un déraciné, symbolisant la construction d'une civilisation qui se coupe de ses racines pour monter en puissance plus vite - trop vite. Quand la famille Salina est encombrée d'un chateau absurde dont on ne connaît même pas toutes les pièces, comme d'une histoire dont le contenu ne signifie plus rien, Antoine est expulsé de son monde familial par son ascension sociale, qu'il n'a finalement pas désirée:Antoine Bloyé, XIV, p. 208 (c'est moi qui souligne)
"Toutes les possessions terrestres des Bloyé auraient tenu sur une charrette à bras:Il s'agit pour nous d'assumer cet "héritage précédé d'aucun testament", car, d'un monde à l'autre, entre décadence et déracinement, c'est à la naissance de notre propre civilisation, républicaine et démocratique, technicienne et aculturée, que nous sommes conviés.
"C'est bien assez bon pour des vieux comme nous", disaient-ils.
A mesure qu'ils vieillissaient, les surface de leur vie diminuait encore, cette vie qui avait toujours été si mince, si peu importante, qui avait éveillé si peu d'échos, touché de ses ondes si peu d'êtres [...] Tous les ans, trois ou quatre jours par an, Antoine retrouvait les meubles, les fantômes des mouvements, les vestiges des pas de son enfance [...] Il songeait qu'on ne vit guère avec les gens qu'on aime, trois jours, quatre jours par ans, quelle dérision! Il leur demandait de venir passer l'hiver chez lui, mais ils refusaient, ils disaient:
"Nous vous gênerions..."
Car ils avaient pris l'habitude de vivre avec un fils imaginaire qui leur semblait trop haut placé pour eux. Les souvenirs d'enfance, les nouvelles du village épuisées, ils n'avaient pas grand-chose à lui dire. Ils étaient chacun dans un monde"Antoine Bloyé, XVIII, p. 256 (c'est moi qui souligne)





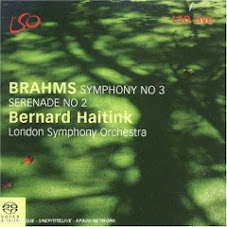









29 commentaires:
Les dernières lignes de Antoine Bloyé que tu cites sont magnifiques. Elles illustrent parfaitement une demande faite par ma sœur lors de mon dernier anniversaire : "allez, dis-nous des mots qu'on comprend pas". Tout le monde a rit, bien sur, mais au-delà de la maladresse elle exprimait quelque chose de tout à fait juste.
Mais passons, je vais profiter de ce très bel article pour dire quelques mots sur Antoine Bloyé. Dans Antoine Bloyé le déracinement s'exprime jusque dans la relation qu'il entretient avec sa femme, ce qui exprime bien la dimension non seulement sociale mais aussi intime de cette souffrance :
«Il y avait des moments où il aurait voulu abandonner cette existence qu'il menait, pour devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'étranger, qui serait vraiment lui-même (...) Un jour, on lui proposa une situation en Chine, comme autrefois, en Angleterre :
«Tu iras seul si tu y tiens, dit Anne... Moi je ne quitterai pas mon pays, mes parents, pour aller vivre chez des sauvages, dans un pays où nous ne connaîtrons personne... Pour une position où il n'y a pas de retraite, pour une aventure!»
(...) Se révolter contre contre la figure présente de sa vie pour mettre en liberté le double qu'on enferme peut-être ! On craint des cris de femmes, des habitudes brisées, on redoute d'être un «monstre» d'une singularité insoutenable, de ne plus être pareil à n'importe qui, on manque de foi : le faux courage attends les grandes occasions, les périls extraordinaires qui ne viennent jamais vous mettre à l'épreuve. Mais le courage véritable consiste chaque jour à vaincre les petits ennemis, Antoine manquait de ce vrai courage, comme tant d'hommes... Il pensa quelque temps à cette chance de métamorphoses qu'il avait eue, puis feignit de l'avoir oubliée :
«Comme tu as bien fait d'écouter mes conseils, disait Anne...
-- Oui... peut-être... Enfin, n'en parlons plus, c'est une affaire réglée», répondait-il
C'était un échec de plus, comme l'Angleterre, comme Marcelle. Il ne faut pas tant de défaites pour renverser un homme. (...)
Quand son beau-père voyait Antoine absorbé, inquiet, il lui disait :
«Ne vous rongez-donc pas, vous prenez les choses infiniment trop à cœur... Il faut être plus philosophe dans la vie...»
Être philosophe, c'était accepter n'importe quoi , les jours comme ils venaient. C'était tomber dans les fosses les plus creuses. Antoine vivait dans un monde ou le mot philosophe signifiait paresse et lâcheté. Et ainsi tout le reste de la personne d'Antoine n'arrivait pas à l'existence : bien des éléments inconnus de lui-même demeuraient au fond du tableau. Antoine était un homme qui avait un métier et un tempérament : c'était tout. C'est tout ce qu'est un homme dans le monde où vit Antoine Bloyé.» A.B p.146-147
La description des voisins des Bloyé donne lieu à une analyse très fine du ressentiment :
«Les voisins des Bloyé ne voulaient pas envier le quartier riche : ils faisaient croire qu'une vie opprimante s'y déroulait (...) incompatibles avec l'idée qu'un petit bourgeois de la province française peut se faire des agréments et de la liberté de la vie. Ils se contentaient, faute de mieux, de se sentir également distants des ouvriers qu'ils méprisaient et des grands bourgeois de qui les mœurs insolites leur fournissaient sans cesse des motifs de ne point désirer plus de pouvoir ou de fortune qu'ils n'en avaient (...) tous les hommes s'exagèrent beaucoup les vices, les soucis, les malheurs de ceux qui sont placés plus haut qu'eux (...) dans leur monde démesurés de personnages tragiques et de héros oisifs (...) Ainsi les habitants des rues modestes se défendaient-ils contre la jalousie sociale, justifiaient-ils leur peu d'éclat : leurs indignations, leurs étonnements les vengeaient, ils se consolidaient de cette manière-là de l'échec de leurs rêves de puissance, de vanité, de richesse : ils enseignaient à leurs fils et à leurs filles, afin qu'ils n'eussent pas de visées trop hautes pour leur condition, la sagesse du juste milieu, la modestie des violettes, la philosophie de l'honnête et de la médiocrité dorée.» A.B p.190-191
Un juste milieu qui n'est pas aristotélicien. Mais ne nous trompons pas, cette revendication de la médiocrité, du moyen, du milieu, cette haine de la démesure, cache un désir et même une certitude d'être rare, peu commun, désir qu'ils expriment entre eux, sans vraiment l'exprimer :
««Quel goût vous avez, madame !
Et Anne répondait, avec modestie :
«C'est tout naturel, j'aime tellement mon chez-moi... Je n'ai vraiment aucun mérite...»
(...) c'étaient des dames orgueilleuses qui parlaient avec beaucoup de auteur des "humbles", des ouvriers, elles disaient d'une personne au-dessous d'elle qu'elle était «ordinaire» ou «commune» (...) elles se sentaient rare (...) Elles semblaient alors parler des mœurs d'une autre espèce animale que la leur, une espèce moins rare... (...) les paysans sont comiques, mais un ouvrier ne fait pas rire, un manœuvre sur son chantier ne se laisserait pas regarder par des dames «comme une bête curieuse...» A.B p.206
Ce mépris intérieur du "petit" ne peut pas sortir de ces murs. Pas lorsqu'il vient de personnes méprisant au même moment le "grand" pour sa démesure, pour sa singularité. Cette classe du ressentiment a besoin de ses Œuvres :
«Elles avaient leurs Œuvres, elles allaient dans le quartier du Toulon porter des conseils et montrer aux mères de famille qu'elles avaient besoin d'être guidées , éclairées par la sagesse des bourgeoises (...) elles disaient :
«Ces gens-là sont extraordinaires, ils sont dans la vie comme des enfants... Quels désordre chez ces femmes, si vous saviez, quel manque d'hygiène... Que feraient-elles, mon Dieu, si elles n'avaient pas des femmes comme nous pour les guider !»»
Et cette femme continue son discours en racontant une anecdote, un spectacle «écœurant» auquel elle a assistée, pour terminer par : «Quelles horreur ! Quelle dégradation ! Ils vivent dans une promiscuité d'animaux...» Elles s'en offusquent, et s'en délectent, car elles ont besoin de cela. Si peu certaines de leur grandeur, elles ont besoin de "ces gens-là", de ces fantasmes, pour se grandir.
Ces discours ne laisse pas Antoine Bloyé indifférent. Ils visent un milieu qui fut le sien et dans lequel il a laissé une famille, un père, une mère qu'il aime. «Et il éclatait parfois (...) il comprenait bien que ces protestations étaient insuffisantes, qu'elles ne compensaient pas sont passage de l'autre côté de la barrière» (p.208). Antoine défend sa femme de faire partie des Œuvres : «Et Anne pensait avec une sorte de colère contre Antoine qu'il ne se dépouillerait jamais de sa première peau, elle pensait à cette formule grossière qu'elle eût rougi de prononcer à haute voix : «La caque sent toujours le hareng !»»
Antoine Bloyé n'a sa place nulle part. Trop éloigné de ses parents et incapable d'appartenir pleinement au milieu auquel il accède. Respectueux de ses racines, mais également respectueux de ceux qui l'entourent, il est incapable de rompre définitivement avec ses racines, et est incapable de détester suffisamment ce milieu qui méprise ce qu'il a été pour pouvoir en sortir. Antoine Bloyé n'est pas capable du «courage véritable», car il craint «des cris de femmes», il craint d'être un «monstre». Ce n'est pas seulement un combat contre l'habitude, c'est un combat contre la gentillesse qui se joue. Antoine Bloyé a trop souffert après avoir vécu trop tranquillement pour pouvoir faire du mal : «Antoine répondait mal à cette question, elle l'entraînait trop loin, elle l'entraînait à dire à Anne des choses qu'elle ne lui pardonnerait plus». Antoine Bloyé est instable et se le cache.
«Voilà, il allait mourir, tout à l'heure, -- il n'avait pas eu de vie. Sa femme disait quelquefois, -- c'était un aspect de cette philosophie des salles à manger, de cette philosophie de tout le monde :
«Est-ce que tu aimerais recommencer ta vie, sachant tout ce que tu sais ?... Moi pas, j'ai eu ma part de peine, j'ai eu mes joies... On ne vit qu'une fois, je ne voudrais pas recommencer, ce serait sûrement la même chose...»
(...) Il était neurasthénique : on pouvait mettre sur son mal une étiquette médicale rassurante (...) il comprenait enfin vaguement qu'il n'aurait pu être sauvé que par des créations qu'il aurait faites, par des exercices de sa puissance. Tout ce qui avait empli sa vie tombait en poussière. Vraiment, s'il pouvait recommencer sa vie et la remplir !» A.B p.277-284
Mais Antoine n'a pas les mots. Déraciné, il se sent étranger. Provenant d'un milieu modeste, il n'a pas les mots pour saisir pleinement ce qui le tourmente, pour fixer sa vie d'homme errant à l'intérieur de lui-même :
«Ce n'était plus de la mort corporelle qu'il avait peur, mais du visage informe de toute sa vie, de cette image vaine de lui-même, de cet être décapité, personne ne s'était rendu compte qu'il avait tout le temps vécu sans tête (...) il était trop tard, il avait tout le temps vécu sa mort. Mais un homme ne peut endurer longtemps ces pensées extrêmes et Antoine finissait par s'accrocher à l'inquiétude la plus précise, la plus claire. (...) Il se voyait au téléphone, chez le médecin, achetant des boîtes de cachets, des gouttes, mesurant son tabac, sa viande. Ces soucis l'endormaient enfin, comme un conte.» A.B. p.309
Le corps d'Antoine Bloyé répond aux habitudes et protège du même coup son âme fuyante. Son corps n'est plus celui du paysan qui travaille la terre pour se nourrir ; il n'est pas non plus le corps pétri de convention de la bourgeoisie, outil au service de son ascension sociale ; le corps d'Antoine est ce lieu au sein duquel son âme s'étouffe, son cœur se dessèche. Son corps est loin de lui.
Le déracinement d'Antoine Bloyé s'accompagne d'une désincarnation. Antoine s'éloigne de son corps, ce lien avec le monde, à mesure qu'il s'éloigne du monde. Et lorsqu'il semble y revenir, qu'il s'en inquiète, c'est pour y projeter sa souffrance, c'est pour tenter de s'éloigner de lui-même. Si le déracinement est si violent, c'est parce que nous ne sommes pas arrivés à arracher toutes les racines, si la désincarnation est si violente, c'est parce que nous n'arrivons jamais vraiment à nous séparer de notre corps. Lorsque nous sommes loin de notre corps, nous somme déjà loin de nous-mêmes, et arrivé à ce stade là nous pouvons nous dire que nous sommes déjà mort.
Antoine Bloyé est donc l'histoire d'un mort-vivant, d'un mort qui n'a l'apparence du vivant que parce que son corps continue de reproduire les gestes qui le font passer aux yeux de ses semblables pour l'un des leurs.
«Notre héritage n'est précédé d'aucun testament», je reprends ta citation de René Char, Élise, pour finalement poser la question suivante : si ce dont nous avons hérités n'est plus une promesse pour l'avenir, un appel à réaliser ce que l'on a préparé pour nous qui est aussi un appel à préparer pour ceux qui arrivent la possibilité de réaliser, de continuer le monde, la civilisation moderne ne risque-t-elle pas de survivre sur la reproduction des vestiges qui nous ont été laissés ? Combien de temps pourrons-nous tenir sur ces vestiges que nous usons et méprisons ? Combien de temps Antoine Bloyé a-t-il pu tenir sur la répétition de gestes lointains ? N'est-ce pas l'histoire d'une morte-vivante que nous sommes en train d'écrire, l'histoire d'une civilisation à laquelle personne n'appartient ?
Mais il faut se rassurer, Antoine Bloyé eut un fils, et ce fils le rendit éternel. Tant que l'homme pourra compter sur son corps pour donner naissance à d'autres hommes c'est, comme le dit Hannah Arendt, la promesse d'un nouveau commencement qui est à chaque fois maintenu.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez vous intéresser à Antoine Bloyé (comme à n'importe quel autre roman de ce pauvre Nizan, du reste), qui me semble être (qui m'a semblé, lorsque je l'ai lu) d'un ennui pesant et d'un didactisme insupportable. En plus, il me semble FAUX de bout en bout, contrairement au Guépard, justement.
Il faudrait peut-être que je relise Nizan, mais, franchement, le courage m'en manque...
Moi je préfère les futilités en ce moment !
Mon Didier, une partie de ma vie est la preuve indubitable que vous vous trompez au moins sur un point : celui de la fausseté du discours de Nizan. Comme vous ne me connaissez pas, je sais qu'une telle argumentation n'est pas d'une grande aide.
"Mon cher Didier", pardon (n'y voyez rien d'ironique, une certaine familiarité est de rigueur sur Internet, et les heures que j'y passe ont tendance à émousser mes bonnes manières ;) )
Néanmoins, le césar du plus long commentaire de blog pour l'année 2007 est attribué à... (Je déchire l'enveloppe de mes petits doigts gourds)... est attribué à...
JEAN-BAPTISTE BOURGOIN ( dit : "Mon Jeannot"...) !!!
Bon, quand je disais que je trouvais cela faux, il ne s'agissait pas des "cas" exposés. Je trouve cela romanesquement faux. Didactique, démonstratif, comme vous voudrez. Mais, encore une fois, j'ai lu cela il y a environ vingt ans, alors...
Sinon, je suis aussi, dans ma famille, celui qui dit des mots qu'on ne comprends pas, qui lit des livres qui emmerdent tous le monde, qui a souvent des idées bizarres sur des choses pourtant simples sur lesquelles tout le monde est d'accord, qu'on soupçonne même de contredire juste pour le plaisir de faire son intéressant. Mais à qui, tout de même, on demande de trancher quand on a un point de litige sur quelque chose "d'intellectuel".
Et j'ajouterai qu'il m'arrive souvent de sentir le retard impossible à combler que prend un homme né dans un milieu où il n'y avait jamais un "vrai" livre, où nul n'écoutait de "vraie" musique, par rapport à son voisin qui, lui, a barboté dans ce bain culturel dès le biberon.
(Et, oui, je refuse d'entrer en lice pour le césar qui vous revient !)
Merci beaucoup à Mlle Elise pour ce billet qui m'a remis en mémoire le très bon souvenir de lecture que constitue - en attendant que je le "réactualise" quelque jour à venir, je ne sais quand - Le Guépard de Lampedusa. En revanche, j'ignorais totalement l'existence de cet Antoine Bloyé de Nizan.
Ceci dit, les extraits que vous donnez à en lire, et a fortiori les longs passages rapportés par Jean-Baptiste, me poussent à émettre une opinion que je vois confortée par le commentaire de Didier, qui a lui l'avantage d'avoir lu le roman, et auquel je joins ma voix: tout cela me semble bien pesamment théorique, didactique, et, oui, sonne faux (romanesquement parlant), alors que Lampedusa dans Le Guépard parvient à incarner son propos dans ses personnages, ses descriptions, etc.
Bien entendu, chacun est libre de ses goûts, et je n'attends plus qu'une chose, chère tenancière des lieux: que vous preniez la défense de Nizan et de son Antoine! :-D
Cette idée d'un Nizan romanesquement faux, dont le didactisme ne s'incarne pas, est intéressante, je la comprends, non pas parce que la partage, mais parce que je comprends parfaitement ce qui peux mener à penser cela.
Nizan est un philosophe, et ce roman est écrit avec la langue d'un philosophe. Cela est beaucoup plus prégnant que chez un Sartre. Or vous faites ici exactement le même genre de critique que celle d'un profane en philosophie, écoutant la pensée d'un philosophe, et disant : «ok, c'est intéressant, mais sortons de la théorie, parlons du concret, du vrai» etc. La pensée d'un grand philosophe, aussi "abstraite" semble-t-elle être, est incarnée, est quelque chose qu'il vit (ce que l'on pense être "abstrait" c'est tout simplement ce que l'on ne voit pas directement non pas parce que ça n'est pas réel, mais parce que notre regard n'a pas appris à le voir concrètement). Quand Nizan écrit Antoine Bloyé il pense à son père. Grossièrement, Antoine c'est son père. C'est bien au contraire un roman puissamment incarné.
@ Didier
Merci pour ce césar, mais cherchez bien sur ce blog il est fort probable que vous trouviez un autre commentaire de ma personne qui puisse concourir au titre ;)
Jean-Baptiste, loin de moi l'idée de dire à un philosophe de sortir de la théorie parce que ce serait trop abstrait. Et si vous, qui connaissez bien mieux le roman de Nizan que moi - qui encore une fois ne peut m'appuyer sur les passages que j'en lis ici -, m'assurez qu'Antoine Bloyé c'est, grosso modo, le père de Nizan, je ne peux que vous croire. Mais ce n'est pas ce que j'entendais en parlant de didactisme et d'incarnation. Je vais tenter de l'exprimer mieux, ou à tout le moins plus en détails:
Lorsque, dans les passages qu'Elise cite, Lampedusa décrit don Calogero dans son frac catastrophique, ou les héritières comme de petites guenons sautant partout, il n'a pas besoin de recourir à une explication théorique "extérieure" pour expliciter son point de vue sur ce que représentent sociologiquement ces personnages, du genre "il ne savait pas qu'il faisait avec bien d'autres adolescents de son âge un des enjeux de la vaste partie que commençaient à engager les principaux maîtres de la bourgeoisie française": ces personnages incarnent un certain état social de façon suffisamment "pleine". De même, la façon dont nous est donnée à voir toute la scène du bal à travers les yeux du prince Fabrizio, à qui tout cela apparaît comme un zoo dont il serait le gardien, est en elle-même suffisamment parlante, pour que l'auteur n'ait pas à interrompre son récit pour intervenir "en voix propre" énoncer sa vision du monde ("Tout encourageait alors la jeunesse ouvrière, les descendants ambitieux des artisans, des petits fonctionnaires, à entrer dans le complot du commandement"), que le personnage représente peut-être, mais qui lui reste étrangère (non seulement Antoine "ne s[ait] rien" de tout cela, mais on l'imagine assez mal penser la société en termes de "complot du commandement", qui sonne à mes oreilles comme un bel exemple de théorisation "nizanienne", reflet de la pensée d'une époque bien postérieure à celle qu'il décrit, et plaquée par dessus). Voilà ce que j'entendais par incarnation et par didactisme.
Entendons-nous bien, je ne dis pas que la théorie philosophique (ou autre) "explicite" doit rester impérativement à la porte du roman. D'abord, il n'y a pas qu'un seul type d'écriture qui serait valable à l'exclusion de tous les autres. Ensuite, un certain nombre de chefs-d'oeuvres romanesques comportent de longues plages théoriques; je pense spontanément, par exemple, à Guerre et Paix (mais là encore, on pourrait "s'amuser" à regarder la différence avec Dostoïevski!). Tout est peut-être affaire d'équilibre ou de la façon dont les deux éléments sont mêlés.
En l'espèce, il faudrait que je lise tout le roman de Nizan pour bien mesurer la chose, mais j'ai d'autres lectures en vues pour le moment (ça me fait d'ailleurs penser que le roman que je suis en train de dévorer, Les Immémoriaux de Ségalen, et dont je compte bien parler sur mon propre blog quand je l'aurais fini une fois les fêtes passées, offre de ce point de vue un exemple assez poussé d'"incarnation" totale d'un discours...). En attendant, dans tous les passages que je trouve dans ce billet et ces commentaires je trouve aussi ce genre de digressions, et je ne peux m'empêcher de penser que tout cela doit être terriblement lourd au bout d'un certain nombre de pages.
Bien entendu, outre la subjectivité inhérente à chaque individu, je dirais que vous regardez la chose avec les yeux du philosophe - comme notre hôtesse d'ailleurs - et moi avec ceux du littéraire: il est donc normal que nous ne soyions pas sensible de la même manière aux mêmes choses... Quand vous dites par exemple: "Nizan est un philosophe, et ce roman est écrit avec la langue d'un philosophe. Cela est beaucoup plus prégnant que chez un Sartre.", j'aurais tendance à analyser les mêmes éléments, d'un point de vue littéraire, en me disant que, oui, Sartre s'en est mieux sorti...
- Sur ces considérations, je vous souhaite à vous, à Elise, et à tous ceux qui passeront par là dans les prochaines heures, une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 !
Ah dommage ! Léopold a cravaché comme une bête pour ravir son César à Jean-Baptiste, mais, non, finalement, ce dernier conserve son trophée. Qui sera remis en jeu dès 2008 !
(Purée, heureusement que je suis là pour faire l'animation, sur ce blog, hein ! Parce que si on compte sur la taulière...)
Wahou, merci pour vos commentaires et vos réflexions croisées qui méritent que je prenne plus de temps (avec un esprit plus clair) pour y répondre.
Juste pour ce soir: je voudrais préciser que le fait de parler dans un même article de ces deux oeuvres ne signifie pas que je les place sur un même plan littéraire. Tout simplement, elles font surgir des réflexions fécondes à mes yeux (et tout simplement je les aies lues successivement!).
Je suis toujours un peu choquée par la façon dont les littéraires disqualifient un auteur pour crime de lèse littérature. Ainsi George Sand, Nizan... Je ne suis pas sûre que le but premier de ces auteurs étaient de faire de la littérature, justement. Quand Flaubert et George Sand échangent, ils savent bien qu'ils ne poursuivent pas le même but: l'un le beau, l'autre, une forme de gagne pain finalement (et ce n'est pas déshonnorer ni la littérature ni George Sand que de le reconnaître!)
Pour autant doit-on s'interdire de considérer sérieusement un auteur parce que son style est mauvais? je ne le pense pas. J'aime beaucoup lire Nizan malgré un style effectivement assez lourd. Mais je ne lis pas Nizan pour me rassasier de beauté...
Sur ce merci encore pour votre fidélité, votre bienveillance et votre esprit critique! Et bonne année à tous.
Bien amicalement.
Léopold, tu trouves sérieusement que Sartre est moins didactique que Nizan? Là pour le coup, je ne suis pas d'accord: pour moi, il est pire! ;-)
Good night et merci de ton passage malgré les préparatifs agrégatifs (charmant!)
Cher Didier,
La taulière vous décerne le 7 d'or de l'animateur le plus politiquement incorrect de la blogosphère. Encore un petit effort et on vous recrute comme procureur du tribunal des flagrants délires (Ah, Desproges, reviens!)!
Bonne soirée!
Ceci dit, JBB a effectivement fait bien pire en matière de commentaire interminable: j'en ai parfois été réduite à en faire des articles, imaginez!
Ah ! non, ah ! non : pas d'accord : George Sand est (littérairement) une sombre merde (et Flaubert le savait et le disait : se reporter à sa correspondance) !
Quant à Sartre et Nizan, ils ont d'ores et déjà plongé tous deux dans le néant, en parler est perdre son temps, il me semble : lisez Joseph Roth, Jean Raspail, and so on...
Et merci pour le 7 d'or !
Justement Didier, je n'ai pas dit que George Sand écrivait bien: j'ai dit que l'on pouvait lire un auteur pour d'autres raisons que pour son style et sa qualité littéraire. J'aime lire George Sand même si efectivement sa plume m'écorche parfois la sensibilité littéraire!
Ceci dit je bsuivrai vos conseils de lecture avec joie. En premier lieu Renaud Camus qu'Inactuel me donne décidément bien envie de découvrir.
Le 7 d'or a été décerné par un jury de personnalités compétentes, vous en êtes digne!
Comment ne pourrais-je pas être d'accord avec Élise ?
Quelle douce répartie!
Elise, désolé si je vous ai choqué
- fut-ce un peu - et a fortiori si vous avez décelé dans mes commentaires quelque réflexe atavique propre au clan étrange des "littéraires". Mon but n'était pas de "disqualifie[r] (Nizan) pour crime de lèse littérature"; je ne m'aventurerais d'ailleurs pas à définir ce que peut bien être la littérature (et j'aurais tendance à me méfier de toute personne prétendant le faire de façon catégorique). Je ne réduis pas tout au style: on peut parfaitement apprécier un(e) auteur(e) pour d'autres qualités.
Maintenant est-ce que Nizan (ou Sand, puisque vous en parlez), voulait faire de la "littérature", je pense que oui. Est-ce que la façon dont ils s'y prennent m'enthousiasme, personnellement et subjectivement? a priori, et en attente d'une lecture plus complète ou d'une quelconque illumination, non. Il se trouve qu'en ce qui concerne Nizan, je crois déceler la source du "problème" qu'il me pose; mais encore une fois tout cela est personnel, et je ne prétends à aucune exclusion systématique de quelque élément que ce soit hors de la pureté d'une sphère qu'on appelerait "littérature".
Quant à savoir si Sartre est moins didactique que Nizan, eh bien, je dirais que ça dépend des oeuvres, et que certaines d'entre elles méritent qu'on s'intéresse encore -un peu- à lui. Mais je m'arrête là: en art comme en religion, on n'en aurait jamais fini de discuter de ce qui dépend, ou non, des oeuvres.
PS: je joins ma voix à la vôtre pour réclamer le retour de Desproges!
Oups Léopold, mes excuses, je pensais qu'on en était arrivés tous deux au tutoiement!
Je ne suis pas sûre que Sand voulait faire de la littérature... elle voulait vivre sa vie avant tout, et ses livres servaient à cela. Un "vrai" auteur est une personne qui sacrifie sa vie à sa quête esthétique comme un sacerdoce.
Au sujet de Nizan, je ne crois pas non plus qu'il recherche la littérature: il cherche, comme tout le monde l'a dit, à illustrer une conception sociologique et politique.
Chez Lampedusa, il y a un mouvement de fond génial qui unit le tout en un grand souffle et c'est infiniment supérieur.
Mais tout est intéressant à mes yeux!
Au fait, connaissez-vous Georges Jean Arnaud ;-) ?
Bonne nuit!!!!
- Pour le tutoiement, c'est fort possible, mais j'ai dû oublier entre-temps. Je te prie d'accepter mes excuses et de ne voir dans mon re-passage au vouvoiement aucun signe de quoi que ce soit d'autre que ma difficulté à gérer ce type d'éléments dans le cadre d'une "connaissance" (encore) uniquement virtuelle (en attendant l'hypothétique rencontre, jadis évoquée, si nos passages respectifs à Paris un jour se conjuguent).
- Pour Lampedusa, évidemment, à s'acharner autour de Nizan on en oublierait presque de le rappeller: oui, Le Guépard est génial et donc l'utiliser comme instrument de comparaison ne peut que fausser les mesures!
- Pour Sand, ma vue est peut-être trompée par le fait que j'ai évité les titres qu'on se fade habituellement dans le jeune âge (les François le Champi, La mare au diable, La petite fadette (justement)) et que je n'ai vraiment rencontré son écriture que récemment, dans des ouvrages de plus grande "ampleur" et ambition comme Consuelo ou Lelia, livres qui ont sans aucun doute pleiiiin de défauts, mais qui témoignent à mon avis de certaines volontés de l'auteure qui ne se réduisent pas uniquement à celle du "gagne pain". Maintenant, si on en est à parler de vocation sacerdotale pour définir le "vrai auteur", ça risque de faire un sacré vide dans le temple de la littérature...
- Enfin, pour G.J. Arnaud, j'allais imprudemment répondre "non", mais la curiosité m'a quand même poussé à vérifier de quoi il s'agissait, et patatra, oui, j'avoue! j'avais oublié son nom mais j'ai bel et bien lu, à une époque où je me repaissais essentiellement de SF, les premiers tomes de La Compagnie des Glaces. Même si mon régime alimentaro-littéraire a évolué depuis, je continue à penser qu'il y a dans ce genre-là un certain nombre d'auteurs et de livres hautement intéressants... mais je n'aurais jamais pensé à inclure ceci dans la liste!! :D
Si ma mémoire ne me trompe, il est clair qu'en comparaison même Nizan et Sand font de la "grande littérature", mais après tout, moi-même, en cette période de vacances, me suis laissé tenter récemment par la lecture d'un petit polar "historique" de troisième zone qu'on m'avait obligemment prêté: psychologie des personnages quasi-inexistante, écriture purement "fonctionnelle", le tout soupoudré d'une forte dose d'érotisme "de série", mais une intrigue suffisamment prenante et un "style" (même si c'est un bien grand mot) suffisamment plaisant (ou en tout cas pas déplaisant) pour passer un moment sympa. Si mes souvenirs sont bons, la description doit "coller" aussi assez bien à La Compagnie des Glaces, non?... Après tout dans les lettres comme en musique, au cinéma, etc., il ne peut pas y avoir que des chefs-d'oeuvre et on n'est pas non plus obligé de ne se nourrir que de ceux-là... Etait-ce le sens de cette question perfide? :-D
Hé hé hé, Léopold: la question perfide sur Georges-Jean Arnaud était un clin d'oeil desprogien!!
Le réquisitoire de Desproges contre l'insipide écrivain commence effectivement ainsi "Qui connait Georges Jean Arnaud?" et suit un chuintement entre "cher cheorches chean" et un épisode savoureux à la BNF avec Poulidor: "qui vois-je à la BNF plongé dans les essais de Montaigne, Poulidor! Salut pipi lui fou-je, euh, salut poupou lui fis-je, connais-tu Georges6jean Arnaud" "non, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois!"
J'en ris rien que d'y penser. Quel mérie de l'avoir lu! J'applaudis!
Bon dimanche!
Argh! Je suis tombé dans le piège qui ne m'était même pas tendu. Double honte: ma méconnaissance du répertoire de Desproges, et cet aveu de lecture inavouable.
Pour ce qui est de la première faute, je promets de me rattraper au plus vite, fut-ce en usant de moyens eux aussi inavouables.
Pour la seconde, je plaide les circonstances atténuantes: j'étais au collège et l'inintérêt foncier de la chose m'a suffisamment frappé pour que je ne poursuive pas plus loin que le 2e tome (voire le 1er, me souviens plus bien...).
Surtout - et quoique ce que j'ai lu du sieur Arnaud me semble se situer dans la moyenne d'une certaine "production industrielle" et que je sois sûr qu'il y ait pire en la matière -, je t'imaginais mal te plonger là-dedans (même si on a tous nos moments de faiblesse), et j'aurais dû me méfier davantage. Le fait d'avoir, dans mon commentaire, donné corps à cette improbable hypothèse me mortifie profondément.
Niarf niarf niarf (rire narquois!!)
Je ne fais pas de commentaires... niarf niarf derechef!
Ceci dit avec moi on peut s'attendre à tout puisque j'ai aimé Consuelo! Alors... Niarf niarf (the last!)!
Pour ma part j'ai lu du Pierre Grimbert et du David Eddings ... "Sympa" comme on dit aujourd'hui.
Merci de rappeller charitablement que nous avons tous fait des erreurs de jeunesse... Moi c'était les Mary Higgins Clark en 5ème... (Mais bon, il faut penser à tous ceux qui en sont restés là ce qui est autrement tragique!)
Moi, j'écris du Michel Brice tous les deux mois. Alors, Arnaud, hein, il en faut plus pour m'impressionner, en matière de nullité.
@ Alexis : à mon avis, si vous ne connaissez pas Desproges, vous pouvez parfaitement demeurer dans cet état d'ignorance, vous ne perdrez vraiment pas grand-chose.
(Mais je sens que je vais encore me faire bannir, là, si je touche aux idoles...)
Mais non Didier, les idoles sont faites pour être déboulonnées... Il en faudra plus pour vous bannir, vous me prenez pour une stalinienne ou quoi?
Quant au Michel Brice et au Georges Jean, je me dis qu'il vaut toujours mieux que les gens LISENT des conneries plutôt qu'ils en regardent.
Enregistrer un commentaire