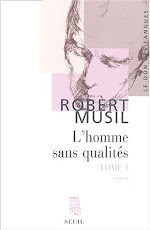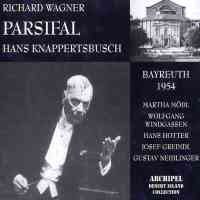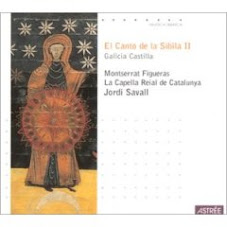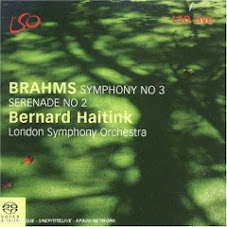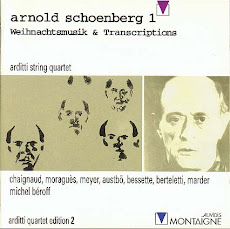Il ne s’agit pas là de nier la pertinence d’une lecture typologique. Le Christ, Verbe de Dieu, constitue la clef de toute intelligence et de tout connaissance du monde visible et invisible, puisque par Lui, tout a été fait[1]. Il est juste et sera toujours juste, lorsque l’on se situe dans une perspective chrétienne, de tout rapporter au Christ. Vivant déjà en Lui et par Lui, nous participons partiellement à la perfection de sa sainteté[2], et c’est bien là que se situe la densité de notre existence : dans l’aspiration de notre finitude à la plénitude de Dieu[3]. C’est ce grand écart que mettent en scène les textes évangéliques, celui du Christ pleinement homme et pleinement Dieu. En ce sens, ils nous sont bien souvent obscurs et abrupts, nous heurtant dans la conscience de notre incapacité quotidienne à assumer nos limites dans notre vocation à participer à la gloire de Dieu. Ici, la lecture du premier testament s’avère décisive. En prenant à l’envers le procédé typologique, on souligne le fait que, si Jésus représente l’aboutissement et la clef des écritures, il est bon de faire retour à celles-ci pour avoir une approche incarnée, humanisée des situations décrites dans l’évangile.
Ainsi, le personnage de Jérémie nous permet d’entrer dans la compréhension de la figure de Jésus comme prophète par excellence. Mais il nous permet également de comprendre de quel ordre est la vocation prophétique de chaque baptisé. Si le baptême nous consacre effectivement prêtre, prophète et roi, nous rendant participants aux ministères du Christ Lui-même, c’est grâce aux grandes figures des prêtres, prophètes et rois du premier testament que nous découvrons des expériences, vécues dans des vies humaines, de l’accomplissement de cette vocation.
Que signifie être prophète ?
Ce qui marque le charisme du prophète, et par là celui du baptisé, c’est un rapport particulier au « monde », ayant une relation privilégiée avec Dieu.
Ce privilège n’est pas fondé sur le mérite personnel, mais bien par l’élection amoureuse de Dieu : « La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu; avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré ; comme prophète des nations, je t'ai établi ». Cette élection est indissociable de la création de l’être humain : la conception d’un nouvel homme dans le ventre d’une femme implique nécessairement et immédiatement son appel à vivre de la vie de Dieu[4]. Dieu nous appelle à vivre une mission qui nous dépasse : c’est pourquoi il crée en nous les charismes nécessaires pour l’accomplir. Ainsi, la peur de Jérémie qui ne se sent pas à la hauteur de l’appel de Dieu : « Et je dis: "Ah! Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant!" ». Dieu lui révèle que la parole qu’il devra adresser ne vient pas de ses capacités humaines, mais de l’autorité divine elle-même : « Mais Yahvé répondit: Ne dis pas: "Je suis un enfant!" car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras ». C’est par grâce que nous sommes appelés : c’est par grâce que nous réalisons ce pour quoi nous sommes appelés…
La vocation qui se réalise par le baptême n’est autre que le rétablissement de l’homme, rendu esclave par le péché, dans la condition filliale: « Aussi n'es-tu plus esclave mais fils; fils, et donc héritier de par Dieu »[5]. Si la condition de l’esclave est inférieure à celle du maître, le fils est appelé à participer à la condition du maître: le ministère prophétique implique donc une participation à l’autorité de Dieu, qui révèle ses volontés afin que son envoyé les fasse connaître aux autres hommes. Le souci, c’est que généralement, ce que Dieu veut dire aux hommes n’est pas précisément ce qu’ils ont envie d’entendre… « Alors Yahvé étendit la main et me toucha la bouche; et Yahvé me dit: Voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois! Aujourd'hui même je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir ».
D’où une définition plus précise de la mission prophétique: le prophète n’est pas l’apôtre, celui qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore, il est avant tout l’aiguillon qui vient mettre en cause les pratiques et les croyances du peuple qui se proclame « Peuple de Dieu ». Il vient « arracher et renverser, exterminer et démolir » toute idolâtrie, afin de « bâtir et planter » les graines de l’adoration véritable qui est dûe à Dieu : « Je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné, ils ont encensé d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'oeuvre de leurs mains. Quant à toi, tu te ceindras les reins, tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai, moi ». Pas vraiment une partie de plaisir : mettre les croyants devant leur péché d’idolatrie, dire à ceux qui croient être les justes qu’ils ne sont que des idolâtres !
Ainsi s’éclaire l’épisode de Luc : « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d'Elie […]; et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Elie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Elisée; et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien ». Que fait effectivement Jésus, sinon révéler aux juifs leur incapacité à recevoir les messages des prophètes qui leur avaient été envoyés par Yahvé ? Il souligne que ce ne sont pas eux, mais les païens, les étrangers, ceux que l’on désigne comme idolâtres, qui ont accueilli la parole libératrice qu’ils apportaient. A plus large échelle, la mission du prophète représente une constante remise en cause des cadres établis par la communauté, tant dogmatiques qu’ecclésiaux. Aussi, la vocation prophétique de chaque baptisé peut-elle être dite moteur d’une catholicité toujours plus grande de l’Eglise, qui ne peut se déployer si ses membres ne repoussent sans cesse ses limites. Il est toujours bien difficile d’être remis en question là où l’on s’estime juste… Et de s’entendre dire que la justice se trouve chez les incroyants ! En transposant la situation dans nos crispations de croyants, on comprend la fureur des juifs, qui emportés par la colère sont prêts à répéter avec Jésus le même schéma de persécution: « Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter ».
Le privilège que représente le partage de l’autorité divine a donc pour contrepartie d’exclure le porteur de la parole de la communauté, hostile à ses messages bien dérangeants. Position délicate pour le prophète, qui subit la violence d’une communauté dont il cherche à assurer le salut… Les livres prophétiques sont émaillés des récits de ces persécutions. Néanmoins, le prophète ne doit pas craindre les hommes : « N'aie aucune crainte en leur présence car je suis avec toi pour te délivrer ». Il n’y a que devant Dieu qu’il soit légitime de trembler : Yahvé lui-même le rappelle à Jérémie avec cette formule frappante, « Ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux ». Trembler devant les hommes, c’est mettre en doute le soutien indéfectible promis par Dieu… et donc le perdre, en perdant confiance.
La vocation du prophète implique une participation à la force qui est celle de Dieu, qui permet de se tenir dans la confiance devant le monde en furie : « Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme ville fortifiée[6], colonne de fer et rempart de bronze devant tout le pays: les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple du pays. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi – oracle de Yahvé - pour te délivrer ». Ce thème n’est pas anodin car il exige de définir précisément quelle est l’expérience chrétienne de la force. Dieu donne effectivement des armes au prophète, mais ce sont avant tout des remparts, un dispositif de défense. Ce rempart étant avant tout, selon la tradition, Dieu lui même : « Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? »[7]… La figure du prophète nous permet donc de comprendre ce que signifie une idée chrétienne de la force, et de lutter conjointement contre une conception lénifiante de la foi – un Dieu mou et gentil qui indique de tendre l’autre joue – autant que contre son contraire, une foi agressive et autoritariste – à l’image d’un Dieu jupitérien. La force qui soutient notre vocation prophétique ne consiste pas en une capacité d’agressivité mais bien dans une potentialité infinie de résistance devant l’adversité. Ainsi, Jésus n’attaque quasiment jamais ses contradicteurs et ses persécuteurs[8], mais il incarne pleinement l’indifférence de l’homme fort de la force de Dieu devant la force mondaine qui s’exprime par la haine : « mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin ». Cette confiance absolue en la force de Dieu s’exprime pleinement à Gethsémani, lorsque le Christ surmonte sa peur de la mort[9].
Cependant, la Croix n’est-elle pas une nouvelle fois l’obstacle définitif à la compréhension de la force ? Effectivement, si Jésus avait réellement possédé cette force de résistance, comment comprendre qu’il soit mort sur la Croix ?
Ce paradoxe nous permet de déterminer quelle est l’identité de la force de Dieu, de l’ « energeia thou theou »[10] qui est donnée au prophète : il s’agit de l’Esprit Saint ; lui qui « a parlé par les prophètes »[11], qui nous est donné comme Paraclet[12]- c’est-à-dire comme défenseur. Le Christ a été jusqu’au bout fort de la force de Dieu, étant pleinement uni, par le mystère trinitaire, à la personne de l’Esprit. Ainsi, si la Croix ne s’explique que par une approche humaine de la force comme violence et cristallisation de la haine, la résurrection ne se peut expliquer que par une identification de la force à l’Esprit Saint, Esprit vivifiant donné en surabondance là où la volonté de mort abonde.
« Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la "philosophie", selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde, et non selon le Christ. […] telle est la circoncision du Christ: ensevelis avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts »[13].
[1] Cf. Symbole de Nicée Constantinople.
[2] Cf. 1Cor. 13 : c’est ce que développe le texte de la seconde lecture de ce 4ème dimanche, sur lequel je ne m’arrête pas plus. « La charité ne passe jamais. Les prophéties? Elles disparaîtront. Les langues? Elles se tairont. La science? Elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant; une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A présent, je connais d'une manière partielle; mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité » (Traduction Bible de Jérusalem).
[3] Les mots en “-itude’’ sont à la mode, je m’en réjouis, j’en abuse.
[4] Cf. Ps 71, 6 : « Sur toi j'ai mon appui dès le sein, toi ma part dès les entrailles de ma mère », et surtout Ps 139, 13-16 : « C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère; je te rends grâce pour tant de prodiges: merveille que je suis, merveille que tes oeuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient » (nous soulignons).
[5] Cf. Ga 4, 7.
[6] L’image de la ville fortifiée n’est pas sans rappeller, à mon avis, la Jérusalem céleste qu’il s’agit de construire.
[7] Cf. Ps 27, 1.
[8] Hormis l’épisode des marchands du Temple, évidemment.
[9] Cf. Mt 26, 36-46.
[10] Cf. Col 2, 12.
[11] Symbole de Nicée Constantinople.
[12] Cf. Jn 14, 26 : « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ».
[13] Cf. Col 2, 8-12.