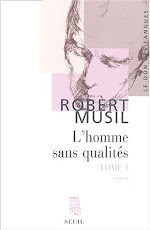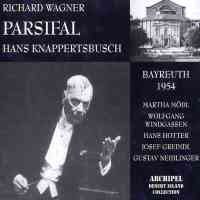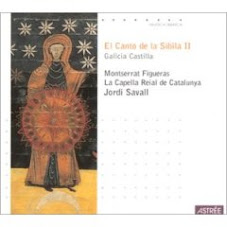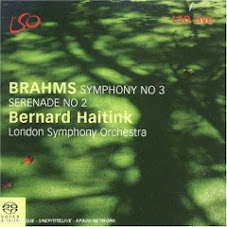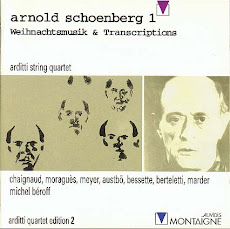Croix comme fuite et malédiction de la vie, Croix comme force pour assumer sa vie ?
Croix comme fuite et malédiction de la vie, Croix comme force pour assumer sa vie ?
Si l’on trouve chez Nietzsche une réelle évaluation de la figure de Jésus, il faut constater son rejet catégorique du « mystère de la Croix ». Par « mystère de la Croix », la théologie catholique entend le sens caché, profond, du scandale de la crucifixion. C’est ce sens qui fait le corps, la substance même du christianisme : la foi en la résurrection du Christ. Ce mystère de la Croix, celui de la mort du Christ comprise comme passage, est le cœur du christianisme, et Nietzsche l’avait bien compris.
C’est pourquoi son attaque du christianisme est axée sur la déconstruction du concept de résurrection. Nietzsche oppose fondamentalement les figures de Jésus, le saint anarchiste, et de Paul, l’homme du ressentiment. La Croix de Jésus est un crime politique : la Croix et la résurrection sont une machine conceptuelle mise en place par Paul, juif épuisé par « la Croix de la Loi ».
Le problème du christianisme doit se comprendre en opposition à la tragédie grecque : Nietzsche la traduit à travers l’opposition entre « Dionysos et le Crucifié ». Il s’agit d’opposer deux sens de la souffrance et deux façon de la vivre : souffrance tragique, souffrance cathartique : la Croix, qui ramène à deux conceptions de la force. La Croix est le centre du mensonge chrétien, car elle est la promesse du bonheur dans un au-delà, et le rejet de la vie dans le monde. Nietzsche stigmatise une opposition entre ici-bas et au-delà caractéristique du christianisme, qui consisterait en une fuite devant le tragique de la vie.
Le Dieu en Croix serait-il une malédiction de la vie ? Il s’agit pour nous d’analyser cette interrogation nietzschéenne, qui sonne comme une alarme lorsque l’on confesse la foi catholique ! Nous travaillerons pour cela à partir des inédits où Nietzsche dialogue avec le christianisme, et de grands textes de l’Antéchrist et de Aurore.
L’analyse de la position nietzschéenne est d’autant plus urgente que la foi en la résurrection est faible en christianisme. On peut constater régulièrement l’attrait des catholiques pour la réincarnation et leur incompréhension du mystère de la résurrection.
Il faut donc donner une substance philosophique au concept de résurrection, à la suite d’Emmanuel Falque
[1]. Pour cela, il est nécessaire de reprendre la critique fondamentale de Nietzsche : pour montrer que la Croix n’est pas l’issue libératrice de la fuite, mais bien une Croix de FORCE qui permet d’assumer sa vie…
Le saint anarchiste et l’inventeur de la christianité : la vérité sur Jésus et le procès de st Paul.
Nietzsche fait de Jésus une image du surhomme : un homme révolté contre les institutions sociales juives. Par conséquent, il comprend sa mort comme un crime politique : c’est l’affirmation que l’on trouve dans les inédits de l’hiver 1887-1888. Ce qui intéresse fondamentalement Nietzsche c’est la puissance de vie qui se dégage de la personne de Jésus.
« Je ne conçois pas contre quoi était dirigée la révolte dont l’auteur fut Jésus : si elle n’a pas été la révolte contre l’Eglise judaïque, - le mot Eglise entendu exactement comme nous l’entendons aujourd’hui… Ce fut une révolte contre les « bons et justes », contre les « saints d’Israël », contre la hiérarchie de la société, non pas contre sa corruption, mais contre la tyrannie de la caste, des mœurs, de la formule, de l’ordre, du privilège, de l’orgueil spirituel, du puritanisme dans le domaine spirituel ; ce fut l’incroyance à l’égard des « hommes supérieurs » au sens spirituel du mot, qui conduisit au soulèvement, attentat à tout ce qui est prêtre ou théologien ; mais la hiérarchie ainsi mise en question était le fondement sur lequel avant tout le peuple juif continuait encore à subsister, la dernière possibilité péniblement conquise d’être un reste, la relique de la singularité de son existence politique : une attaque contre elle était une attaque contre le plus profond instinct national, contre la volonté de conservation de soi judaïque. Ce saint anarchiste qui appela le bas peuple, les exclus et les « pécheurs » à la protestation contre la « classe dominante » - et cela dans une langue qui aujourd’hui encore conduirait en Sibérie – était un criminel politique, pour autant, bien entendu, qu’un crime politique fût encore possible dans ces circonstances. C’est ce qui le mît en croix, témoin l’inscription de la croix : le roi des Juifs »[2]
Avant tout, Jésus représente la révolte de l’esprit libre contre les classes dominantes : il est un criminel politique, lui qui se disait « roi des juifs ». La vie et le message de Jésus n’ont en ce sens rien à voir avec le message désigné comme mortifère du christianisme, qui se fonde sur la croix : ce qui est important c’est « la vie réelle, la vie en vérité» que Jésus a mené.
« Jésus opposait à cette vie ordinaire une vie réelle, une vie en vérité : rien n’est plus éloigné de lui que le non-sens grossier d’un « Pierre éternisé », d’une éternelle prolongation de la personne. Ce qu’il combat, c’est cette manière pour la « personne » de faire l’important : pourquoi peut-il vouloir éterniser justement celle-ci ?
Il combat de même la hiérarchie à l’intérieur de la communauté : il ne promet en aucune façon de proportionner la récompense à la conduite : comment a-t-il pu vise châtiment et récompense dans l’au-delà ? »[3]Jésus est une figure du surhomme, en tant qu’il a assumé le tragique de l’existence jusqu’au bout : il a vécu réellement, et n’avait aucune idée de l’éternité et de la résurrection, concepts inventés par Paul. Par cette existence exceptionnelle, Jésus est l’image d’un bonheur possible sur terre de façon effective
« On voit ce qui a pris fin avec la mort sur la croix : l’ébauche nouvelle et parfaitement originale d’un mouvement de paix bouddhiste, d’un bonheur sur terre effectif et non plus seulement promis. Car – je l’ai déjà souligné – telle reste la différence fondamentale entre les deux religions de décadence : le bouddhisme ne promet pas, mais tient ; le christianisme promet tout, mais ne tient rien. – la « Bonne nouvelle » fut suivie, sur les talons, de la pire de toutes : celle annoncée par Paul. En l’apôtre Paul s’incarne le type opposé à celui du « messager de bonne nouvelle » : le génie dans la haine, dans la haine visionnaire, dans la logique implacable de la haine. Que n’a-t-il pas sacrifié à la haine, ce « Dysangéliste » ! »[4]
Message comparable à celui du bouddhisme, celui de la possibilité d’assumer le tragique de l’existence, qui « donne valeur à l’être en tant qu’assez sacré pour justifier encore une immensité de souffrance ».
« Dionysos contre le « Crucifié » : vous avez là l’opposition. Ce n’est pas une différence par rapport au martyr – simplement celui-ci a un autre sens. La vie elle-même, sa fécondité et son retour éternels, conditionne le tourment, la destruction, la volonté d’anéantir. Dans l’autre cas, la souffrance, le « crucifié en tant que l’innocent » a valeur comme objection contre cette vie-ci, comme formule de condamnation. On le devine : le problème est celui du sens de la souffrance : un sens chrétien ou un sens tragique. Dans le premier cas, elle doit être le chemin vers un être sacré ; dans le dernier cas, elle donne valeur à l’être en tant qu’assez sacré pour justifier encore une immensité de souffrance. L’homme tragique affirme encore la souffrance la plus amère : il est assez fort, assez plénier, assez apte à diviniser pour cela ; le chrétien nie encore le sort le plus heureux de la terre : il est assez faible, assez pauvre, assez déshérité pour souffrir de la vie sous n’importe quelle forme. Le Dieu en croix est une malédiction de la vie, un avertissement pour s’en sauver ; le Dionysos écartelé est une promesse de vie : il renaîtra éternellement et reviendra de sa résurrection »[5]Ce message de vie, ce message de force « a pris fin avec la mort sur la croix » : c’est cette croix que Nietzsche attaque directement, et non la figure de Jésus qui selon lui n’aurait rien à voir avec le christianisme ! En ce sens, la conception nietzschéenne se rapproche de la théologie hérétique socinienne, avatar de la Réforme, développée au XVIIème siècle en Pologne à la suite de Fausto Socin. Ces chrétiens rejetaient le dogme de la Sainte Trinité : leur conception de Jésus est proche de celle de Nietzsche en tant qu’elle nie la divinité du Christ et le mystère de la Croix. Pour eux, Jésus est un homme envoyé par le Père pour guider les hommes sur la voie de la vie éternelle : Il est « servator » et non « salvator ». Pour ces pensées, ce qui prime c’est avant tout l’exemple de la vie de Jésus, qui est pour les sociniens l’exemple à suivre pour accéder à la vie éternelle ; pour Nietzsche, elle est l’image de la vie réelle, qui assume le tragique dans la pensée de l’éternel retour. La vie réelle est la force de pouvoir assurer que, s’il fallait revivre cette vie tragique, on la revivrait : c’est cette pensée la plus lourde, de l’éternel retour, qui doit être assumée. La Croix serait alors une fuite devant le tragique de l’existence par la promesse d’un bonheur dans l’au-delà ? Pour Nietzsche, Jésus était une figure de vie et de puissance. Qu’est-ce qui a fait du christianisme une religion de la mort, prenant pour cœur la Croix et le sacrifice d’une victime expiatoire?
L’accusation de Nietzsche porte sur Paul : la figure du juif fatigué par « la Croix de la Loi »
[6]. C’est Paul et non Jésus, qui a fondé le christianisme
[7], qui a créé la machine conceptuelle de la Croix et de la Rédemption… C’est lui qui est l’inventeur de la « christianité » : celui qui a converti la « Bonne Nouvelle » de Jésus (le bonheur est possible effectivement sur cette terre, dans le fait d’assumer le souffrance de façon tragique) en « la pire de toutes » : la souffrance d’ici-bas sera convertie en bonheur dans l’au-delà ! Comment Jésus aurait-il pu « viser châtiment et récompense dans l’au-delà »
[8], lui le révolté contre les hiérarchies et les institutions juives ? C’est Paul, le juif zélateur, éprouvant douloureusement l’écart entre la Loi et son incapacité à l’accomplir, qui est responsable de ce système de compensation : il est l’annonciateur de la « logique implacable de la haine […] », lui, le « ‘Dysangéliste’ » !
Nietzsche décrit la conversion du chemin de Damas (Actes des Apôtres, XI) comme une crise d’épilepsie d’où jaillit l’éclat d’une bonne idée : Paul, épuisé par « la loi […] la croix sur laquelle il se sentait cloué […] comme il cherchait partout le moyen de l’anéantir, - de ne plus avoir à l’accomplir en personne ! » est « illuminé par une pensée salvatrice » : celle que le Christ, en mourrant sur la Croix, accomplit la Loi et délivre l’homme du poids de cette Loi… Paul découvre une doctrine qui libère l’homme du ressentiment : il a l’intuition fondamentale du christianisme, celle de la rédemption par la Croix. C’est la volonté de vengeance et de ressentiment de Paul que Nietzsche stigmatise quand il attaque le christianisme : il faut surmonter le christianisme cette image du Dieu en croix, malédiction de la vie.
« surmonter tout ce qui est chrétien par quelque chose de surchrétien et ne pas seulement s’en débarrasser – car la doctrine chrétienne fut la contre doctrine qui s’opposa à la doctrine dionysiaque »[9]
« - Ce qui nous distingue nous, ce n’est pas de ne retrouver aucun Dieu, ni dans l’histoire, ni dans la nature, ni derrière la nature – c’est de ressentir ce que l’on a vénéré sous le nom de « Dieu », non comme « divin », mais comme pitoyable, comme absurde, comme nuisible, non seulement comme une erreur mais comme un crime contre la vie… Nous nions Dieu ne tant que Dieu. Si l’on nous prouvait ce Dieu des chrétiens, nous saurions encore moins y croire. Formule : « Deus, qualem Paulus creavit, dei negatio » - »[10]
« Deus qualem Paulus creavit dei negatio » : Le Dieu créé par Paul est une négation de Dieu… La Croix serait donc l’idée de génie de Paul, la solution au problème de la Loi ; en instaurant l’idée d’une autre vie, elle se comprend comme négation de cette vie. Par ce rejet de la vie, le Dieu élevé sur la croix se nie lui-même en tant que Dieu ! Mais Nietzsche ne prend en compte qu’un aspect du mystère de la Croix (mort et résurrection du Christ) lorsqu’il la rapporte à la rédemption. Pour la doctrine chrétienne, la mort du Christ n’est pas le sacrifice d’une victime expiatoire, voulu par Dieu, pour le salut de l’humanité ! Comment penser le christianisme positivement, grâce aux critiques cathartiques de Nietzsche ? Il s’agit de résoudre deux problèmes posés par Nietzsche au christianisme : celui de la force et celui de « l’autre vie » (résurrection).
Dionysos et le Crucifié : le paralogisme de la force et le problème de la résurrection
La question qui se pose, à travers l’opposition Dionysos et le Crucifié, est celle de la force. La philosophie de Nietzsche, si l’on choisit de suivre la ligne d’interprétation de Deleuze, est une philosophie de la force[11]. La violence des attaques nietzschéennes contre le christianisme tient dans la dénonciation de ce qu’il appelle « le paralogisme de la force » : le christianisme a complètement converti le sens des mots « force » et « faiblesse » par le catalyseur de la Croix. Avec l’idée de la rédemption surgit l’idée que l’au-delà justifie, récompense la souffrance ici-bas. Cette conception cathartique de la souffrance est opposée par Nietzsche à la conception tragique. Le christianisme n’a pas pour privilège de prendre en charge la souffrance ; il la comprend au sens d’un dépassement (Salut : Croix), alors que la tragédie grecque est l’expression de la lucidité face à la souffrance : la reconnaissance que nous vivons dans la souffrance, mais qu’il n’y a pas d’autre voie que de l’assumer sans récompense. Face à la lucidité d’Œdipe, au Dionysos écartelé, le Crucifié, le ressuscité est la figure de la fuite et du mensonge d’un au-delà compensateur. La Croix est l’entrée par la souffrance dans une autre vie, véritable, où se trouvera le bonheur ; alors que le « Dionysos écartelé » est promesse de pouvoir assumer cette vie par la souffrance. La question que Nietzsche pose aux chrétiens est celle ci : êtes vous capables de vivre en supportant la pensée de devoir revivre cette vie tragique ?
Le christianisme rejette la force : conséquence, ce que Nietzsche appelle « l’euthanasie du christianisme »[12], c’est-à-dire sa dégénérescence en un « doux moralisme ». Cette dégradation s’explique par la mésinterprétation de ce qui fait la force et le noyau du christianisme, le concept de la résurrection et le mystère de la Croix. Il s’agit principalement de repenser le problème de la force à partir de l’analyse qu’en donne Nietzsche. La souffrance et la mort du Christ en Croix n’est pas un sacrifice : elle est l’aboutissement de l’Incarnation, c’est-à-dire de la prise en charge de la finitude humaine (naissance, mort : temporalité et chair, corporéité : spatialité et passibilité) par le Fils, afin qu’elle soit transfigurée par la FORCE de l’Esprit. L’Esprit Saint est en christianisme ce qui accomplit en l’homme la force : il est la réponse chrétienne au paralogisme de la force[13]. A partir de là, qu’en est-il de la résurrection ? Impossible de comprendre la Croix comme la malédiction de cette vie, promesse du passage à une autre vie.
Si l’accusation de la vie terrestre reste trop souvent présente aux consciences chrétiennes, le procès tenu par Nietzsche doit être l’occasion de repenser philosophiquement les concepts chrétiens, à partir de la doctrine fondatrice de Paul : ce que fait Emmanuel Falque. Faut-il penser que la Croix est une fuite vers l’au-delà ? Nous affirmerons au contraire qu’elle est une force pour assumer sa vie. Il faut d’abord achever les vieux schémas dualistes en christianisme, fruit d’une lecture néo-platonicienne simplifiée. Ainsi, on peut affirmer contre Nietzsche qu’il n’y a pas d’arrière monde en christianisme : l’opposition ici-bas et au-delà, centrée sur l’axe de la Croix ne doit pas avoir cours. Il s’agit bien de CE monde ci, qui sera recréé à la fin des temps ; tout comme il s’agit de CETTE vie terrestre qui sera transfigurée par la résurrection finale. La promesse de la résurrection, si elle est promesse du royaume, n’est pas celle d’une autre vie, mais celle de la transfiguration en Christ de notre vie terrestre. Il ne s’agit nullement d’un système de compensation dans l’au-delà.
En outre, le christianisme ne promet pas qu’un bonheur à venir (lors de l’avènement du royaume de Dieu, à la fin des temps), mais un bonheur effectif : le royaume, par la Croix de Jésus-Christ, est déjà en marche à travers ceux qui suivent l’Evangile : ceux qui vivent « selon l’Esprit » ceux qui se reconnaissent comme citoyens de la « Civitas Dei ». Le Christ, par sa Pâque glorieuse, a donné à l’homme la grâce de déjà vivre dans le royaume de Dieu…sur cette terre, maintenant ! C’est par la Croix du Christ, à laquelle les hommes sont invités à participer, que ce bonheur est promis : par le sacrement du baptême, le chrétien passe par la Croix ; dès lors il est ressuscité, il vit d’une vie nouvelle, de la vie l’Esprit Saint.
Dès la vie terrestre, la Croix est une chance de transfigurer sa vie, avec tout son sens tragique : elle est la promesse du soutien de l’Esprit Saint comme force dans la tâche d’assumer la finitude - la souffrance et la mort.
Mai 2005.
[1] Conférence Nietzsche et st Paul, éternel retour et résurrection des corps, Espace Catherine de Sienne, Tours, 06/12/2004 ; Métamorphose de la finitude, essai philosophique sur la naissance et la résurrection, Cerf, Paris, 2004, coll. « la nuit surveillée ».
[2] Inédits de l’hiver 1887-1888
[3] Ibid.
[4] Antéchrist
[5] Inédit de 1888
[6] Aurore, I, 68
[7] Sur st Paul : voir Aurore, I, parag.68 « le premier chrétien ».
[8] Cf. op. cit., second texte cité.
[9] Inédit de 1881.
[10] Antéchrist, parag. 47.
[11] Nietzsche et la philosophie, PUF Quadrige, 1962.
[12] Aurore, parag.92 « au lit de mort du christianisme »
[13] Selon Emmanuel Falque.