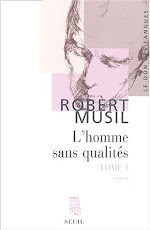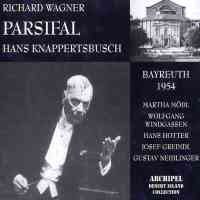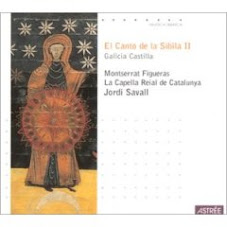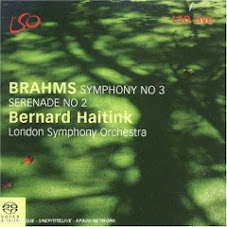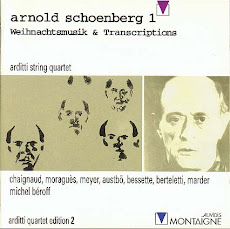IntroductionElise m’a fort gentiment proposé de disserter sur la notion de « joie » chez Spinoza ; je dois avouer que je fus initialement rétif à une telle proposition, d’une part parce que mes compétences en matière de Spinoza sont plus que limitées, et parce que, d’autre part, Spinoza est désormais accolé à un infamant 4 obtenu à un commentaire de texte à l’agrégation…
Mais, chacun ici le sait, nul ne saurait rien refuser à Elise, et je me suis vu dans l’obligation presque inconsciente d’accepter une telle offre. J’en profite pour te remercier, chère Elise, de m’accueillir sur ton blog, et de m’avoir donné l’occasion de travailler, fût-ce fort imparfaitement, ces textes qui me demeurent tant obscurs.
Je le répète, Spinoza est à mes yeux incompréhensible. Incompréhensible parce que contrairement aux Méditations de Descartes, par exemple, je ne suis jamais parvenu à reproduire moi-même l’itinéraire spirituel proposé par Spinoza, afin de parvenir à la béatitude. Car, il ne faut jamais l’oublier, Spinoza nous convie, dans l’Ethique, à la béatitude ; qui a refermé l’ouvrage doit avoir, sous peine de mécompréhension, atteint une béatitude éternelle. « C’est en ce sens, écrit Alquié, qu’il se sépare de tous les philosophes occidentaux de l’époque moderne. On n’a pas assez insisté sur cette différence, pas assez averti, au début de toute étude consacrée à Spinoza, que nous quittons avec lui le terrain sur lequel Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant se sont placés. Or, c’est de cette différence que provient l’incompréhensibilité de l’Ethique. »
[1]A la suite d’Alquié, donc, je le dis clairement : je ne comprends pas Spinoza.
La question de la joie spinoziste est un concept central de l’Ethique, un pivot même pourrions-nous dire, mais un concept que, au même titre que l’Ethique en son entier, je ne comprends pas. Pourtant, si l’on regarde les définitions, la joie est on ne peut plus limpide : une passion par laquelle l’âme passe à une perfection plus grande. Cette notion de « passage » est capitale, ainsi que je tenterai de le démontrer ultérieurement ; il est essentiel de comprendre que la joie n’est pas un état, mais un passage, une transition, et en aucun cas, comme le remarque Delbos
[2], une perfection en acte, comme on en trouve tant chez Aristote ou dans la scolastique.
L’essentiel du problème amené par la joie au sein du système spinoziste réside dans sa nature : bien que joie, elle est définie comme passive, ce qui grève d’avance la possibilité même d’une joie totale : l’extériorité de la cause sera toujours source de tristesse, laissera toujours la porte ouverte à une titillatio coquine qui viendra nous taquiner. Une joie pleinement vécue serait dès lors une joie active, une joie que l’âme connaîtrait en se contemplant elle-même ; mais une telle possibilité, cela est évident, engage la totalité du système spinoziste, pour être accomplie. Autrement dit, la joie charrie avec elle l’entièreté de l’Ethique, en ce que, ainsi que je vais tenter de le montrer, elle suppose le passage – le saut – dans la béatitude et la liberté divine pour être véritablement vécue et expérimentée. C’est à la possibilité d’un tel saut qu’est consacré le présent article.
I°) Sens et nature de la joiea) La joie est un affectLa première occurrence de la « joie » dans l’Ethique se situe fort significativement dans un scolie, plus précisément dans la scolie de la proposition 11 du livre III. Ces quelques indications topographiques délivrent des renseignements de toute première importance quant à la nature de la joie spinoziste ; tout d’abord, sa localisation au sein du livre III témoigne clairement du fait que la joie est un affect, c’est-à-dire une affection du corps, susceptible d’augmenter ou de diminuer :
« Par affect, (per affectum), j’entends les affections du Corps, qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient, la puissance d’agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections. Si donc nous pouvons être cause adéquate d’une de ces affections, alors par l’Affect j’entends une action ; autrement une passion
[3]. »
Par cette définition capitale, il nous est ainsi donné une alternative et une seule : si la joie relève des affects, alors elle est soit passive, soit active. Pour que la joie soit un affect actif, encore faut-il que nous soyons cause adéquate, c’est-à-dire cause « dont l’effet peut se percevoir clairement et distinctement par elle. »
[4] Dans tous les autres cas, la joie relèvera de la passivité.
Par ailleurs, Spinoza définit l’affect par un critère de variabilité, d’augmentation et de diminution, si bien que là encore, il faudra que Spinoza définisse la joie par cela même qui se trouve susceptible d’une oscillation.
Enfin, Spinoza prend la peine de distinguer l’affection qui a une efficace sur le corps de l’idée de cette affection, qui aura nécessairement une efficace sur l’Esprit, et non sur le corps.
Savoir que la joie est localisée dans le livre III, et donc dans la section consacrée aux affects, nous délivre donc d’emblée trois renseignements majeurs avant même que nous n’ayons abordé la définition de la joie en tant que telle :
1) La joie peut être active ou passive
2) La joie est un processus d’augmentation ou de diminution.
3) La joie pourra se rapporter au corps et / ou à l’esprit.
Ainsi que nous l’annoncions précédemment, c’est la proposition XI du livre III qui introduit la joie comme moment capital de la réflexion spinoziste :
« Toute chose qui augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance d’agir de notre corps, l’idée de cette même chose augmente ou diminue, aide ou contrarie, la puissance de penser de notre Esprit. »
[5]Je ne reprendrai pas la démonstration de cette proposition, mais je vais essayer d’en montrer les implications : si l’Esprit peut être aidé ou contrarié, si l’Esprit est susceptible de connaître de telles variations quant à sa puissance, c’est qu’il existe des passages, des transitions, au sein même de l’Esprit, qui lui font connaître de telles variations. Le passage d’un état inférieur à un état supérieur, pour l’esprit, sera qualifié de « joie », tandis que l’inverse, c’est-à-dire la dégradation de l’état supérieur vers l’état inférieur sera qualifié de « tristesse ». Pour autant, l’Esprit qui recherche la plénitude ne recherche en rien ces instabilités permanentes, qui le font osciller de la contrariété à la satisfaction, et de la satisfaction à la contrariété ; l’oscillation même du mouvement de la joie et de la tristesse témoigne qu’il s’agit là d’une passion, que l’Esprit subit, et en aucun cas d’une action.
« Par Joie (Laetitiam) j’entendrai donc, dans la suite, une passion par laquelle l’Esprit passe à une plus grande perfection. Et, par Tristesse (Tristitiam), une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. »
[6]b) La joie est transitio
Le premier résultat capital quant à la nature de la joie est ici clairement établi : la joie et la tristesse, loin d’être des états stables, prennent la forme de passages, de transitions, passages qui portent en eux le fait qu’il s’agit de phénomènes passifs, où l’esprit pâtit de son instabilité affective, et non de phénomènes actifs où l’Esprit déciderait de se perdre dans une oscillation sans fin. Toutefois, la troisième condition énoncée par Spinoza dans le cas de l’affect portait sur le rapport de celui-ci non seulement à l’esprit, mais aussi au corps ; or, jusqu’à présent, la joie s’est cantonnée clairement à une oscillation de l’Esprit, sans que le corps ne trouve de raison pour intervenir. C’est ici que la rigueur spinoziste entre en jeu, et impressionne par sa cohérence : le corps, chez Spinoza, est clairement défini comme l’ « objet de l’Esprit », si bien que l’Esprit ne connaît jamais que les affections du corps
[7]. Si, donc, l’Esprit perçoit ces passages, ces transitions que sont la joie et la tristesse, alors il perçoit nécessairement en même temps les affections du corps qui y correspondent. Si bien que l’on obtient le résultat suivant : la joie et la tristesse, en tant qu’elles se rapportent à l’Esprit, relèvent nécessairement du corps tandis que si elles se rapportent au corps, elles ne sont pas nécessairement perçues par l’Esprit.
Cette disjonction où tout ce qui est perçu par l’Esprit relève du corps, tandis que tout ce qui relève du corps ne se rapporte pas nécessairement à l’Esprit est magnifiquement exprimée dans la suite du scolie :
« De plus, l’affect de Joie, quand il se rapporte à la fois à l’Esprit et au Corps, je l’appelle Chatouillement ou Allégresse (Titillationem vel hilaritem) ; et l’affect de la Tristesse, Douleur ou Mélancolie. »
[8]Le caractère simultané rendu par la séquence « quand il se rapporte à la fois …» est ici fort significatif ; il n’est pas systématique que la joie et la tristesse concernent à la fois l’esprit et le corps, ce qui signifie, en clair, que la joie et la tristesse ne se rapportent pas toujours à l’esprit puisque si joie et tristesse étaient nécessairement des variations spirituelles, l’objet de celles-ci serait corporel, auquel cas Spinoza ne prendrait pas la peine de préciser l’éventualité des cas où joie et tristesse se rapportent à la fois à l’Esprit et au corps.
Cette clarification sémantique et conceptuelle de la joie et de la tristesse nous a ainsi livré deux résultats et une promesse.
Tout d’abord, la joie et la tristesse ne sont pas des états mais des devenirs, des transitions (Spinoza emploie le terme latin de transitio), ce qui signifie que la joie et la tristesse constituent des passages au sein de l’esprit et du corps. Il est également indubitable que ce sont des passions, que subissent le corps et l’Esprit, lesquels se retrouvent ballottés de part et d’autre par cette incessante oscillation des affects. Toutefois, de cette situation instable naît une promesse : de même qu’il est possible de quitter les états de contrariété pour atteindre la satisfaction dans un mouvement que Spinoza nomme « joie », de même il semble possible de dépasser cette passivité déplorable pour asseoir une joie active ; telle est la promesse à laquelle nous convie Spinoza. « Le projet pratique de l’Ethique, écrit Jean-Marie Vaysse, qui est de montrer comment on peut passer de la servitude passionnelle à la liberté de la raison, est donc indissociable d’une théorie de l’affectivité expliquant comment aller de la tristesse à la joie et des passions aux actions. »
[9]
c) Un cas particulier de la joie : l’AmourAller de la tristesse à la joie, et de la passion aux actions, tel est le programme qui nous est imparti. Il va de ce fait nous falloir trouver une situation où la joie ne soit pas fondamentalement passive ; or, une telle quête est d’emblée impossible ou contradictoire car ce serait remettre en cause le résultat précédent, à savoir la nature passive de la joie et de la tristesse. Spinoza est donc logiquement acculé à dériver l’objet de la joie, ou plutôt de placer aux côtés de la joie par essence passive, quelque chose de l’ordre de l’activité. Ce à quoi va donc se livrer Spinoza, c’est à une définition d’un cas particulier de la joie, celui où celle-ci se trouve accompagnée d’une cause extérieure. Autrement dit, au lieu que l’on en reste à une joie comme passage d’un état interne soumis à la passivité, on assiste ici à une causalité externe accompagnant la joie : cette joie accompagnée d’une cause extérieure, Spinoza lui donne un nom précis : l’amour.
« l’Amour n’est rien d’autre qu’une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure, et la Haine, rien d’autre qu’une Tristesse qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. »
[10]Ce scolie spinoziste a deux implications majeures :
1) L’amour n’a de sens que vis-à-vis d’une extériorité. Il n’y a d’amour que si la joie parvient à être accompagnée de cette cause extérieure. Il n’est pas possible de soutenir qu’il s’agit ici d’un amour de soi.
2) Pour autant, l’amour demeure une modalité dérivée de la joie, et demeure à ce titre très certainement passif. Il ne s’agit en rien d’une relation biunivoque entre deux êtres, l’amant et l’aimé, mais d’un terme synthétique, l’amour, où prime très nettement l’amant, puisque son amour est abordé à partir de sa joie propre. Nulle réciprocité dans l’amour spinoziste, il ne s’agit pas de penser l’amour entre deux êtres, mais de comprendre comment cette cause extérieure accompagnant la joie peut contribuer à l’obtention du salut pour un individu, et non pour le couple.
L’amour, somme toute, par lequel la joie est accompagnée d’une cause extérieure ne résout en rien le problème de la passivité de la joie ; de fait, Spinoza poursuit ses propositions en qualifiant l’amour et la haine par des termes nettement passifs.
« Qui imagine affecté de Joie ou bien de Tristesse ce qu’il aime sera lui aussi affecté de Joie ou bien de Tristesse ; et l’un et l’autre affect sera plus ou moins grand dans l’amant, selon que l’un et l’autre est plus ou moins grand dans la chose aimée. »
[11]Outre qu’il y va toujours de l’amant, et jamais de l’aimé, ce qui se comprend parfaitement dans la logique spinoziste du salut, l’affect domine sans partage, ce qui signifie clairement que la passivité domine dans l’exacte mesure où la cause extérieure ne saurait être cause adéquate.
II°) Y a-t-il des joies actives ?a) L’interprétation de Gilles DeleuzeIl semble à ce stade que nulle possibilité de fonder une joie active ne soit donc possible ; l’amour lui-même porte en lui son lot de passivité, précisément parce que la cause qui accompagne la joie passive demeure extérieure, et ne saurait devenir adéquate ; disons-le franchement, Spinoza ne parle pratiquement jamais de « joie active », ce serait là une parfaite contradictio in adjecto. Pourtant, un commentateur, et pas des moindres, a tenté d’interpréter ce monstre hybride de la joie active, afin de remédier à ce cette aporie de la joie passive, dans le but de tenter un saut vers une « joie active », locution qui n’apparaît pas comme telle dans l’Ethique. Ce commentateur est évidemment Gilles Deleuze, dont je vais tenter de restituer le raisonnement : la question qu’il pose est fort simple au demeurant : est-il possible de transformer la cause extérieure de l’amour en cause adéquate ? Dès lors qu’il y a joie, il y a augmentation de la puissance, l’augmentation étant même confondue avec le passage induit par la translatio de la laetitia. S’il y a action joyeuse, elle résulte d’une cause interne. « Quand Spinoza suggère que ce qui convient avec la raison peut aussi en naître, il veut dire que toute joie passive peut donner lieu à une joie active qui s’en distingue seulement par la cause. »
[12]Il faut ici être très ferme : jamais Spinoza ne dit explicitement qu’il existe des joies actives, et du reste, le phrasé de Deleuze ne dit pas autre chose : quand Spinoza dit x, il faut entendre y. Or, si Spinoza dit effectivement x, il ne dit pas textuellement y, y étant la fameuse « joie active »…
La thèse de Deleuze, parce qu’elle est célèbre et intéressante mérite d’être étudiée dans toute sa force interprétative : peut-on envisager une joie formée par une cause adéquate, interne, une cause dont les effets seraient immédiatement intelligibles puisque immanents ? A mieux y regarder, la question que pose Deleuze n’est pas furieusement révolutionnaire : elle ne fait qu’examiner la possibilité décrite par Spinoza lui-même d’un affect actif, en tant que nous en serions cause adéquate
[13]. Toutefois, la voie qu’il propose pour y répondre s’avère assez originale ; pour que l’on ait une cause adéquate, il faut partir d’un raisonnement juste, nécessairement fondé sur des notions communes, seules prémisses valables aux yeux de Spinoza. Si nous voulons obtenir une joie active, il nous faut de ce fait déterminer quelles sont les notions communes constituant le point de départ du raisonnement, lesquelles notions communes nous feront comprendre les rapports de convenance et de disconvenance.
b) L’éphémère argument des notions communesDe toute évidence, les notions communes se rapportent à ce que Spinoza nomme le « deuxième genre de connaissance », c’est-à-dire à la raison
[14]. Or, nous dit Deleuze, dans le deuxième genre de connaissance, caractérisé par les notions communes, nous en restons aux notions inadéquates d’affection, elles ne deviendraient adéquates que dans le troisième genre. Cet argument est à la fois violemment faux, en ce qu’il occulte la caractéristique majeure de la connaissance du deuxième genre qui consiste justement à avoir des idées adéquates des propriétés des choses, et de mauvaise foi car il consiste à dissimuler totalement une question spinoziste posée par la nature même de la joie que je vais détailler sous peu.
Au fond, la thèse de Deleuze est simple à comprendre : la joie ne devient véritablement active que dans la liberté divine, donc dans la béatitude où, nous dit Deleuze, « procédant de l’idée de nous-mêmes telle qu’elle est en Dieu, nos joies actives sont une partie des joies de Dieu. »
[15] Il n’y aurait donc de joies actives que dans le cadre de la béatitude, donc à l’issue de la cinquième partie de l’Ethique dans l’exacte mesure où la béatitude se définit justement comme la « possession d’un amour actif tel qu’il est en Dieu. »
[16] Outre la terminologie assez flottante qu’emploie Deleuze, passant indifféremment de la joie active à l’amour actif, il s’agit de bien saisir le nerf de la pensée deleuzienne : pourquoi le deuxième genre de connaissance ne suffirait-il pas à assurer la possibilité d’une joie active, puisque ledit deuxième genre se définit justement par la cause adéquate ?
c) Du deuxième au troisième genre de connaissanceLa réponse de Deleuze à la question précédente est surprenante : parce que Dieu, dans le deuxième genre, puisqu’il ne pense pas par notions communes, ne peut ressentir de joie active, il nous faut somme toute renoncer au deuxième genre de connaissance et plonger dans le troisième. Autrement dit, selon Deleuze, la joie active véritable ne pourrait être que celle dont Dieu est capable, et cela infirme immédiatement la possibilité de celle-ci au sein du deuxième genre, ce qui expliquerait du reste l’insolente absence de la locution « joie active » avant le cinquième livre de l’Ethique.
Une telle thèse eût été acceptable si, dans l’économie générale de sa thèse, Deleuze avait respecté deux conditions :
1) si Deleuze n’avait pas entamé son raisonnement par la nécessité d’une cause adéquate qui semblait somme toute s’arrêter au deuxième genre de connaissance.
2) Si Deleuze, moins aveuglé par sa fascination de l’immanentisme, avait reconnu une certaine hésitation spinozienne.
Il est tout à fait vrai que selon Spinoza, le troisième genre de connaissance naît du second
[17] et qu’à ce titre un dépassement des notions communes est envisageable. De surcroît, il est vrai qu’une variation de la joie et de l’amour refait surface dans le cinquième livre : connaître par le troisième genre, nous dit Spinoza, nous donne du plaisir. Mais cela ne nous dit pas pourquoi Deleuze a tant insisté sur la nécessité d’une cause adéquate comme condition nécessaire et suffisante de la joie active, ce qui ne semble pas être finalement le cas aux yeux de Deleuze, ni pourquoi le saut dans la béatitude s’avère indispensable. Tout se passe comme si Deleuze s’était rendu compte en cours de route que la joie active ne se réalisait pas avec les seules causes adéquates du deuxième genre et que, lui-même surpris par cette non-réalisation, il avait occulté l’incompréhensible besoin du saut dans la béatitude pour que celles-ci se réalisent. En somme, pour le dire clairement, si l’on comprend très clairement pourquoi les joies actives se réalisent dans la béatitude, il est incompréhensible qu’elles ne se réalisent pas dans les causes adéquates du deuxième genre, et cette non-réalisation ne nous est guère explicitée par Deleuze alors même qu’il avait annoncé la nécessité de leur réalisation…
III°) Joie active et Amour intellectuela) La joie de comprendre DieuNous sommes désormais en plein dans la béatitude et c’est en elle qu’il nous faut quêter des traces de la joie active, comme accomplissement plénier de celle-ci.
« Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu. »
[18] Comprendre que Dieu est éternel, c’est immédiatement lui vouer un amour éternel. Ainsi, « l’amour intellectuel de Dieu qui naît du troisième genre de connaissance est éternel. »
[19]Il est capital de ne pas mésinterpréter le texte : ce que Spinoza affirme est assez clair : c’est parce que je connais que j’aime Dieu. Mieux, l’amour pour Dieu est le résultat de la quête cognitive achevée par le troisième genre, si bien que la finalité éthique n’est autre que l’accomplissement de la connaissance ; ainsi que le déclare avec justesse Matheron, « le Souverain Bien, loin d’avoir seulement pour condition nécessaire la connaissance vraie de Dieu, se définit tout entier par elle ; la béatitude, c’est la joie de comprendre Dieu (…). »
[20]Il est capital de comprendre ici comment la joie est pleinement active en tant qu’elle est l’acte même de connaissance et de compréhension divins, elle est ce passage cognitif qui a mené à Dieu. Matheron a pleinement raison d’insister sur le fait que le souverain bien n’est autre que la connaissance totale de Dieu par laquelle il m’est donné de l’aimer. Autrement dit, le souverain bien est à la fois un accomplissement du processus cognitif et la totalité de celui-ci ; la nature géométrique de l’Ethique veut que la béatitude soit constituée de l’entièreté des propositions qui l’ont générée. Dès lors, la joie de comprendre Dieu n’est autre que l’entièreté des propositions qui ont mené à cet état.
b) L’amour de Dieu : du génitif objectif au génitif subjectif et l’hésitation spinozienneSi la joie de comprendre Dieu est précisément le fait de le connaître, il serait pleinement logique que Dieu s’aime lui-même dans l’exacte mesure où il se connaît. C’est précisément ce que déclare Spinoza dans le livre V :
« L’Amour intellectuel (Amor intellectualis) de l’Esprit envers Dieu est l’Amour même de Dieu, dont Dieu s’aime lui-même, non en tant qu’il est infini, mais en tant qu’il peut s’expliquer par l’essence de l’Esprit humain, considéré sous l’aspect de l’éternité (sub specie aeternitatis), c’est-à-dire, l’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est une partie de l’Amour infini dont Dieu s’aime lui-même. »
[21]Dans une certaine mesure, eu égard à la logique générale de l’ouvrage, il est tout à fait nécessaire que Dieu s’aime dès lors qu’il se connaît ; mais un point demeure obscur : pourquoi Spinoza parle-t-il encore d’amour ? L’amour, on s’en souvient était une cause extérieure accompagnant une joie. Or, il est ici manifeste que Dieu est cause de sa joie, que cela suffit à l’aimer. En somme, Dieu ne peut être que aimé par l’homme (et par lui-même) puisqu’il ne lui est plus extérieur ; mais dans ce cas, pourquoi est-ce encore de l’amour, puisque la cause n’est plus extérieure ? On aurait pu croire que Spinoza aurait, entre temps, changé de définition de l’amour ; mais il n’en est rien, l’amour du livre V est toujours une cause extérieure accompagnant une joie. Comment comprendre cela ? Je partagerais volontiers l’interprétation d’Alquié selon laquelle les indécisions finales, voire les hésitations du livre V témoignent bien de la « juxtaposition de deux doctrines différentes, résultant elles-mêmes de deux exigences opposées »
[22] : Spinoza n’a pas pu ni su trancher entre le Dieu impersonnel qu’il appelait de ses vœux, ce fameux Deus sive natura et le Dieu personnel, hérité de la Bible et de sa culture personnelle. De là cette indécision entre un Dieu pleinement immanent, et un Dieu qui conserve quelque chose de la transcendance, indécision qui se retrouve pleinement entre la nécessité de faire de l’amour une cause immanente, et la définition même de l’amour qui suppose l’extériorité de la cause.
c) Spinoza et HeideggerQuoi qu’il en soit, si l’amour intellectuel est pleinement amour, il doit nécessairement être joie, puisque l’amour est, ne l’oublions, pas une forme particulière de la joie. Cette joie active qui prend la forme de l’amour intellectuel au sein de la béatitude, telle semble être la seule forme possible de réalisation de la joie comme activité, au cours du projet de l’Ethique. Autrement dit, l’amour intellectuel comme seule forme possible de joie active revêt un caractère d’authenticité, comme si, somme toute, les formes précédentes de joie étaient frappées d’un caractère inauthentique : toute la passivité qui grève les joies du livre III résulte de quelque chose comme la finitude même, comme la limitation nécessaire des perfections, du point de vue de leur cause. Si bien que je serais tout à fait enclin à suivre l’interprétation brillante de Jean-Marie Vaysse, fort bien résumée en un bref article, et que l’on pourrait exprimer, avec lui, en ces termes : « La joie éthique ne serait ainsi qu’un autre nom pour dire ce que Sein und Zeit appelle angoisse. De même que chez Heidegger l’angoisse est la seule tonalité affective authentique, la joie-béatitude est chez Spinoza le seul affect qui ne soit plus une passion (…). »
[23]Si Vaysse compare, avec raison, l’angoisse heideggerienne à la joie active spinozienne accomplie au sein de la béatitude, c’est que, dans les deux cas, il y va de la liberté. L’angoisse est précisément ce qui met le Dasein devant son « être libre pour… » tout comme la béatitude est le lieu de la liberté accomplie. Tout se passe comme si, chez Spinoza et Heidegger on ne vivait pleinement qu’au moment précis où s’ouvrait devant nous cette immensité, ce gouffre de la liberté absolue, bref ce moment où l’on quittait la conscience. Il n’y a d’accomplissement que lorsque l’objet cesse d’être objet, il n’y a de joie véritable que lorsque nous sommes à nous-mêmes notre propre objet de joie, que lorsque Dieu que nous aimons, nous aime parce qu’il se reconnaît en nous. Il n’y a d’activité, en somme, que lorsque la conscience se fait passive, que lorsque la conscience n’a plus d’objet face à elle.
« Joie, joie, joie », en définitive, ne prend tout son sens qu’au terme de la quête intellectuelle qui s’achève dans la béatitude, où la liberté pleine et vécue ouvre sur l’incommensurable, l’infini béat de la vie en Dieu.
ConclusionLa question de la joie apparaît, au terme de ce bien trop bref article, dans toute sa difficulté : il n’y a de joie active, et donc authentique, véritable, pleinement vécue que dans la béatitude, c’est-à-dire dans ce stade que peu de lecteurs, selon toute vraisemblance, ont connu et expérimenté.
De toute évidence, la joie action aurait dû se réaliser dans le deuxième genre de connaissance, et plus précisément lorsque Spinoza avait énuméré la consistance de la générosité, de la force d’âme, de la fermeté, etc. Toutes ces actions engendraient des passages menant vers une plus grande perfection. Les causes étaient ici adéquates, internes, et pourtant Deleuze crut bon de déporter l’accomplissement réel des joies actives au sein du troisième genre de connaissance, en ce sens que la substitution de la nécessité interne à la passivité externe générait la liberté divine, du livre V. Ce mouvement est légitime, puisqu’au fond, c’est celui qu’observe Spinoza ; toutefois, on ne peut que déplorer l’absence réelle de compréhension de la nécessité du passage, et, plus profondément de la raison pour laquelle le deuxième genre est lacunaire ou insuffisant quant à l’obtention de la joie active.
Pourquoi ce saut que rien ne laissait préfigurer ? Je crois que somme toute il est très difficile d’admettre qu’une cause adéquate suffirait à rendre active une joie, puisque cela supposerait que l’âme, se contemplant elle-même, parviendrait à faire de la joie une action. Et cela, Alquié a pleinement raison, c’est incompréhensible, ce qui me ferait dire que Deleuze n’a pas compris non plus ce processus, ce qui explique sa relative impasse quant à l’explication de celui-ci. Dès lors, il est directement passé à la question de la béatitude, laquelle présente l’incommensurable mérite d’être clairement exposée par Spinoza : il va de soi que dans la béatitude, toute joie ne sera qu’active.
Seulement, au moment même où la logique du système est davantage compréhensible, la possibilité de l’expérimenter s’écroule ; si nous pouvions tous expérimenter le deuxième genre de connaissance, il est fort peu crédible que nous soyons en mesure de parvenir au troisième, si bien que si les joies actives ne s’accomplissent véritablement que dans la béatitude, nous sommes pratiquement condamnes à ne jamais les connaître.
En somme, le scepticisme à l’égard de la pensée spinoziste que je reprends à Alquié provient d’un problème capital, et qui court tout au long de l’Ethique : le passage du deuxième au troisième genre. Est-il réellement possible, à l’aide d’un enchaînement géométrique, de quitter le point de vue du deuxième genre, et de plonger au sein du troisième, c’est-à-dire dans l’infinie liberté de la béatitude ? Avec Alquié, j’avoue que je ne le crois pas, et je préfère, pour finir avec mes habituelles lubies, la dialectique hégélienne pour résoudre les contradictions réelles que les mathématiques, fussent-elles géniales, ne sauront jamais résorber.
 Ill: Rémi Brague et moi, subitement saisie d'un profond sentiment d'imposture...
Ill: Rémi Brague et moi, subitement saisie d'un profond sentiment d'imposture...