Introduction
Elise m’a fort gentiment proposé de disserter sur la notion de « joie » chez Spinoza ; je dois avouer que je fus initialement rétif à une telle proposition, d’une part parce que mes compétences en matière de Spinoza sont plus que limitées, et parce que, d’autre part, Spinoza est désormais accolé à un infamant 4 obtenu à un commentaire de texte à l’agrégation…
Mais, chacun ici le sait, nul ne saurait rien refuser à Elise, et je me suis vu dans l’obligation presque inconsciente d’accepter une telle offre. J’en profite pour te remercier, chère Elise, de m’accueillir sur ton blog, et de m’avoir donné l’occasion de travailler, fût-ce fort imparfaitement, ces textes qui me demeurent tant obscurs.
Je le répète, Spinoza est à mes yeux incompréhensible. Incompréhensible parce que contrairement aux Méditations de Descartes, par exemple, je ne suis jamais parvenu à reproduire moi-même l’itinéraire spirituel proposé par Spinoza, afin de parvenir à la béatitude. Car, il ne faut jamais l’oublier, Spinoza nous convie, dans l’Ethique, à la béatitude ; qui a refermé l’ouvrage doit avoir, sous peine de mécompréhension, atteint une béatitude éternelle. « C’est en ce sens, écrit Alquié, qu’il se sépare de tous les philosophes occidentaux de l’époque moderne. On n’a pas assez insisté sur cette différence, pas assez averti, au début de toute étude consacrée à Spinoza, que nous quittons avec lui le terrain sur lequel Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant se sont placés. Or, c’est de cette différence que provient l’incompréhensibilité de l’Ethique. »[1]
A la suite d’Alquié, donc, je le dis clairement : je ne comprends pas Spinoza.
La question de la joie spinoziste est un concept central de l’Ethique, un pivot même pourrions-nous dire, mais un concept que, au même titre que l’Ethique en son entier, je ne comprends pas. Pourtant, si l’on regarde les définitions, la joie est on ne peut plus limpide : une passion par laquelle l’âme passe à une perfection plus grande. Cette notion de « passage » est capitale, ainsi que je tenterai de le démontrer ultérieurement ; il est essentiel de comprendre que la joie n’est pas un état, mais un passage, une transition, et en aucun cas, comme le remarque Delbos[2], une perfection en acte, comme on en trouve tant chez Aristote ou dans la scolastique.
L’essentiel du problème amené par la joie au sein du système spinoziste réside dans sa nature : bien que joie, elle est définie comme passive, ce qui grève d’avance la possibilité même d’une joie totale : l’extériorité de la cause sera toujours source de tristesse, laissera toujours la porte ouverte à une titillatio coquine qui viendra nous taquiner. Une joie pleinement vécue serait dès lors une joie active, une joie que l’âme connaîtrait en se contemplant elle-même ; mais une telle possibilité, cela est évident, engage la totalité du système spinoziste, pour être accomplie. Autrement dit, la joie charrie avec elle l’entièreté de l’Ethique, en ce que, ainsi que je vais tenter de le montrer, elle suppose le passage – le saut – dans la béatitude et la liberté divine pour être véritablement vécue et expérimentée. C’est à la possibilité d’un tel saut qu’est consacré le présent article.
I°) Sens et nature de la joie
a) La joie est un affect
La première occurrence de la « joie » dans l’Ethique se situe fort significativement dans un scolie, plus précisément dans la scolie de la proposition 11 du livre III. Ces quelques indications topographiques délivrent des renseignements de toute première importance quant à la nature de la joie spinoziste ; tout d’abord, sa localisation au sein du livre III témoigne clairement du fait que la joie est un affect, c’est-à-dire une affection du corps, susceptible d’augmenter ou de diminuer :
« Par affect, (per affectum), j’entends les affections du Corps, qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient, la puissance d’agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections. Si donc nous pouvons être cause adéquate d’une de ces affections, alors par l’Affect j’entends une action ; autrement une passion[3]. »
Par cette définition capitale, il nous est ainsi donné une alternative et une seule : si la joie relève des affects, alors elle est soit passive, soit active. Pour que la joie soit un affect actif, encore faut-il que nous soyons cause adéquate, c’est-à-dire cause « dont l’effet peut se percevoir clairement et distinctement par elle. »[4] Dans tous les autres cas, la joie relèvera de la passivité.
Par ailleurs, Spinoza définit l’affect par un critère de variabilité, d’augmentation et de diminution, si bien que là encore, il faudra que Spinoza définisse la joie par cela même qui se trouve susceptible d’une oscillation.
Enfin, Spinoza prend la peine de distinguer l’affection qui a une efficace sur le corps de l’idée de cette affection, qui aura nécessairement une efficace sur l’Esprit, et non sur le corps.
Savoir que la joie est localisée dans le livre III, et donc dans la section consacrée aux affects, nous délivre donc d’emblée trois renseignements majeurs avant même que nous n’ayons abordé la définition de la joie en tant que telle :
1) La joie peut être active ou passive
2) La joie est un processus d’augmentation ou de diminution.
3) La joie pourra se rapporter au corps et / ou à l’esprit.
Ainsi que nous l’annoncions précédemment, c’est la proposition XI du livre III qui introduit la joie comme moment capital de la réflexion spinoziste :
« Toute chose qui augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance d’agir de notre corps, l’idée de cette même chose augmente ou diminue, aide ou contrarie, la puissance de penser de notre Esprit. »[5]
Je ne reprendrai pas la démonstration de cette proposition, mais je vais essayer d’en montrer les implications : si l’Esprit peut être aidé ou contrarié, si l’Esprit est susceptible de connaître de telles variations quant à sa puissance, c’est qu’il existe des passages, des transitions, au sein même de l’Esprit, qui lui font connaître de telles variations. Le passage d’un état inférieur à un état supérieur, pour l’esprit, sera qualifié de « joie », tandis que l’inverse, c’est-à-dire la dégradation de l’état supérieur vers l’état inférieur sera qualifié de « tristesse ». Pour autant, l’Esprit qui recherche la plénitude ne recherche en rien ces instabilités permanentes, qui le font osciller de la contrariété à la satisfaction, et de la satisfaction à la contrariété ; l’oscillation même du mouvement de la joie et de la tristesse témoigne qu’il s’agit là d’une passion, que l’Esprit subit, et en aucun cas d’une action.
« Par Joie (Laetitiam) j’entendrai donc, dans la suite, une passion par laquelle l’Esprit passe à une plus grande perfection. Et, par Tristesse (Tristitiam), une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. »[6]
b) La joie est transitio
Le premier résultat capital quant à la nature de la joie est ici clairement établi : la joie et la tristesse, loin d’être des états stables, prennent la forme de passages, de transitions, passages qui portent en eux le fait qu’il s’agit de phénomènes passifs, où l’esprit pâtit de son instabilité affective, et non de phénomènes actifs où l’Esprit déciderait de se perdre dans une oscillation sans fin. Toutefois, la troisième condition énoncée par Spinoza dans le cas de l’affect portait sur le rapport de celui-ci non seulement à l’esprit, mais aussi au corps ; or, jusqu’à présent, la joie s’est cantonnée clairement à une oscillation de l’Esprit, sans que le corps ne trouve de raison pour intervenir. C’est ici que la rigueur spinoziste entre en jeu, et impressionne par sa cohérence : le corps, chez Spinoza, est clairement défini comme l’ « objet de l’Esprit », si bien que l’Esprit ne connaît jamais que les affections du corps[7]. Si, donc, l’Esprit perçoit ces passages, ces transitions que sont la joie et la tristesse, alors il perçoit nécessairement en même temps les affections du corps qui y correspondent. Si bien que l’on obtient le résultat suivant : la joie et la tristesse, en tant qu’elles se rapportent à l’Esprit, relèvent nécessairement du corps tandis que si elles se rapportent au corps, elles ne sont pas nécessairement perçues par l’Esprit.
Cette disjonction où tout ce qui est perçu par l’Esprit relève du corps, tandis que tout ce qui relève du corps ne se rapporte pas nécessairement à l’Esprit est magnifiquement exprimée dans la suite du scolie :
« De plus, l’affect de Joie, quand il se rapporte à la fois à l’Esprit et au Corps, je l’appelle Chatouillement ou Allégresse (Titillationem vel hilaritem) ; et l’affect de la Tristesse, Douleur ou Mélancolie. »[8]
Le caractère simultané rendu par la séquence « quand il se rapporte à la fois …» est ici fort significatif ; il n’est pas systématique que la joie et la tristesse concernent à la fois l’esprit et le corps, ce qui signifie, en clair, que la joie et la tristesse ne se rapportent pas toujours à l’esprit puisque si joie et tristesse étaient nécessairement des variations spirituelles, l’objet de celles-ci serait corporel, auquel cas Spinoza ne prendrait pas la peine de préciser l’éventualité des cas où joie et tristesse se rapportent à la fois à l’Esprit et au corps.
Cette clarification sémantique et conceptuelle de la joie et de la tristesse nous a ainsi livré deux résultats et une promesse.
Tout d’abord, la joie et la tristesse ne sont pas des états mais des devenirs, des transitions (Spinoza emploie le terme latin de transitio), ce qui signifie que la joie et la tristesse constituent des passages au sein de l’esprit et du corps. Il est également indubitable que ce sont des passions, que subissent le corps et l’Esprit, lesquels se retrouvent ballottés de part et d’autre par cette incessante oscillation des affects. Toutefois, de cette situation instable naît une promesse : de même qu’il est possible de quitter les états de contrariété pour atteindre la satisfaction dans un mouvement que Spinoza nomme « joie », de même il semble possible de dépasser cette passivité déplorable pour asseoir une joie active ; telle est la promesse à laquelle nous convie Spinoza. « Le projet pratique de l’Ethique, écrit Jean-Marie Vaysse, qui est de montrer comment on peut passer de la servitude passionnelle à la liberté de la raison, est donc indissociable d’une théorie de l’affectivité expliquant comment aller de la tristesse à la joie et des passions aux actions. »[9]
c) Un cas particulier de la joie : l’Amour
Aller de la tristesse à la joie, et de la passion aux actions, tel est le programme qui nous est imparti. Il va de ce fait nous falloir trouver une situation où la joie ne soit pas fondamentalement passive ; or, une telle quête est d’emblée impossible ou contradictoire car ce serait remettre en cause le résultat précédent, à savoir la nature passive de la joie et de la tristesse. Spinoza est donc logiquement acculé à dériver l’objet de la joie, ou plutôt de placer aux côtés de la joie par essence passive, quelque chose de l’ordre de l’activité. Ce à quoi va donc se livrer Spinoza, c’est à une définition d’un cas particulier de la joie, celui où celle-ci se trouve accompagnée d’une cause extérieure. Autrement dit, au lieu que l’on en reste à une joie comme passage d’un état interne soumis à la passivité, on assiste ici à une causalité externe accompagnant la joie : cette joie accompagnée d’une cause extérieure, Spinoza lui donne un nom précis : l’amour.
« l’Amour n’est rien d’autre qu’une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure, et la Haine, rien d’autre qu’une Tristesse qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. »[10]
Ce scolie spinoziste a deux implications majeures :
1) L’amour n’a de sens que vis-à-vis d’une extériorité. Il n’y a d’amour que si la joie parvient à être accompagnée de cette cause extérieure. Il n’est pas possible de soutenir qu’il s’agit ici d’un amour de soi.
2) Pour autant, l’amour demeure une modalité dérivée de la joie, et demeure à ce titre très certainement passif. Il ne s’agit en rien d’une relation biunivoque entre deux êtres, l’amant et l’aimé, mais d’un terme synthétique, l’amour, où prime très nettement l’amant, puisque son amour est abordé à partir de sa joie propre. Nulle réciprocité dans l’amour spinoziste, il ne s’agit pas de penser l’amour entre deux êtres, mais de comprendre comment cette cause extérieure accompagnant la joie peut contribuer à l’obtention du salut pour un individu, et non pour le couple.
L’amour, somme toute, par lequel la joie est accompagnée d’une cause extérieure ne résout en rien le problème de la passivité de la joie ; de fait, Spinoza poursuit ses propositions en qualifiant l’amour et la haine par des termes nettement passifs.
« Qui imagine affecté de Joie ou bien de Tristesse ce qu’il aime sera lui aussi affecté de Joie ou bien de Tristesse ; et l’un et l’autre affect sera plus ou moins grand dans l’amant, selon que l’un et l’autre est plus ou moins grand dans la chose aimée. »[11]
Outre qu’il y va toujours de l’amant, et jamais de l’aimé, ce qui se comprend parfaitement dans la logique spinoziste du salut, l’affect domine sans partage, ce qui signifie clairement que la passivité domine dans l’exacte mesure où la cause extérieure ne saurait être cause adéquate.
II°) Y a-t-il des joies actives ?
a) L’interprétation de Gilles Deleuze
Il semble à ce stade que nulle possibilité de fonder une joie active ne soit donc possible ; l’amour lui-même porte en lui son lot de passivité, précisément parce que la cause qui accompagne la joie passive demeure extérieure, et ne saurait devenir adéquate ; disons-le franchement, Spinoza ne parle pratiquement jamais de « joie active », ce serait là une parfaite contradictio in adjecto. Pourtant, un commentateur, et pas des moindres, a tenté d’interpréter ce monstre hybride de la joie active, afin de remédier à ce cette aporie de la joie passive, dans le but de tenter un saut vers une « joie active », locution qui n’apparaît pas comme telle dans l’Ethique. Ce commentateur est évidemment Gilles Deleuze, dont je vais tenter de restituer le raisonnement : la question qu’il pose est fort simple au demeurant : est-il possible de transformer la cause extérieure de l’amour en cause adéquate ? Dès lors qu’il y a joie, il y a augmentation de la puissance, l’augmentation étant même confondue avec le passage induit par la translatio de la laetitia. S’il y a action joyeuse, elle résulte d’une cause interne. « Quand Spinoza suggère que ce qui convient avec la raison peut aussi en naître, il veut dire que toute joie passive peut donner lieu à une joie active qui s’en distingue seulement par la cause. »[12]
Il faut ici être très ferme : jamais Spinoza ne dit explicitement qu’il existe des joies actives, et du reste, le phrasé de Deleuze ne dit pas autre chose : quand Spinoza dit x, il faut entendre y. Or, si Spinoza dit effectivement x, il ne dit pas textuellement y, y étant la fameuse « joie active »…
La thèse de Deleuze, parce qu’elle est célèbre et intéressante mérite d’être étudiée dans toute sa force interprétative : peut-on envisager une joie formée par une cause adéquate, interne, une cause dont les effets seraient immédiatement intelligibles puisque immanents ? A mieux y regarder, la question que pose Deleuze n’est pas furieusement révolutionnaire : elle ne fait qu’examiner la possibilité décrite par Spinoza lui-même d’un affect actif, en tant que nous en serions cause adéquate[13]. Toutefois, la voie qu’il propose pour y répondre s’avère assez originale ; pour que l’on ait une cause adéquate, il faut partir d’un raisonnement juste, nécessairement fondé sur des notions communes, seules prémisses valables aux yeux de Spinoza. Si nous voulons obtenir une joie active, il nous faut de ce fait déterminer quelles sont les notions communes constituant le point de départ du raisonnement, lesquelles notions communes nous feront comprendre les rapports de convenance et de disconvenance.
b) L’éphémère argument des notions communes
De toute évidence, les notions communes se rapportent à ce que Spinoza nomme le « deuxième genre de connaissance », c’est-à-dire à la raison[14]. Or, nous dit Deleuze, dans le deuxième genre de connaissance, caractérisé par les notions communes, nous en restons aux notions inadéquates d’affection, elles ne deviendraient adéquates que dans le troisième genre. Cet argument est à la fois violemment faux, en ce qu’il occulte la caractéristique majeure de la connaissance du deuxième genre qui consiste justement à avoir des idées adéquates des propriétés des choses, et de mauvaise foi car il consiste à dissimuler totalement une question spinoziste posée par la nature même de la joie que je vais détailler sous peu.
Au fond, la thèse de Deleuze est simple à comprendre : la joie ne devient véritablement active que dans la liberté divine, donc dans la béatitude où, nous dit Deleuze, « procédant de l’idée de nous-mêmes telle qu’elle est en Dieu, nos joies actives sont une partie des joies de Dieu. »[15] Il n’y aurait donc de joies actives que dans le cadre de la béatitude, donc à l’issue de la cinquième partie de l’Ethique dans l’exacte mesure où la béatitude se définit justement comme la « possession d’un amour actif tel qu’il est en Dieu. »[16] Outre la terminologie assez flottante qu’emploie Deleuze, passant indifféremment de la joie active à l’amour actif, il s’agit de bien saisir le nerf de la pensée deleuzienne : pourquoi le deuxième genre de connaissance ne suffirait-il pas à assurer la possibilité d’une joie active, puisque ledit deuxième genre se définit justement par la cause adéquate ?
c) Du deuxième au troisième genre de connaissance
La réponse de Deleuze à la question précédente est surprenante : parce que Dieu, dans le deuxième genre, puisqu’il ne pense pas par notions communes, ne peut ressentir de joie active, il nous faut somme toute renoncer au deuxième genre de connaissance et plonger dans le troisième. Autrement dit, selon Deleuze, la joie active véritable ne pourrait être que celle dont Dieu est capable, et cela infirme immédiatement la possibilité de celle-ci au sein du deuxième genre, ce qui expliquerait du reste l’insolente absence de la locution « joie active » avant le cinquième livre de l’Ethique.
Une telle thèse eût été acceptable si, dans l’économie générale de sa thèse, Deleuze avait respecté deux conditions :
1) si Deleuze n’avait pas entamé son raisonnement par la nécessité d’une cause adéquate qui semblait somme toute s’arrêter au deuxième genre de connaissance.
2) Si Deleuze, moins aveuglé par sa fascination de l’immanentisme, avait reconnu une certaine hésitation spinozienne.
Il est tout à fait vrai que selon Spinoza, le troisième genre de connaissance naît du second[17] et qu’à ce titre un dépassement des notions communes est envisageable. De surcroît, il est vrai qu’une variation de la joie et de l’amour refait surface dans le cinquième livre : connaître par le troisième genre, nous dit Spinoza, nous donne du plaisir. Mais cela ne nous dit pas pourquoi Deleuze a tant insisté sur la nécessité d’une cause adéquate comme condition nécessaire et suffisante de la joie active, ce qui ne semble pas être finalement le cas aux yeux de Deleuze, ni pourquoi le saut dans la béatitude s’avère indispensable. Tout se passe comme si Deleuze s’était rendu compte en cours de route que la joie active ne se réalisait pas avec les seules causes adéquates du deuxième genre et que, lui-même surpris par cette non-réalisation, il avait occulté l’incompréhensible besoin du saut dans la béatitude pour que celles-ci se réalisent. En somme, pour le dire clairement, si l’on comprend très clairement pourquoi les joies actives se réalisent dans la béatitude, il est incompréhensible qu’elles ne se réalisent pas dans les causes adéquates du deuxième genre, et cette non-réalisation ne nous est guère explicitée par Deleuze alors même qu’il avait annoncé la nécessité de leur réalisation…
III°) Joie active et Amour intellectuel
a) La joie de comprendre Dieu
Nous sommes désormais en plein dans la béatitude et c’est en elle qu’il nous faut quêter des traces de la joie active, comme accomplissement plénier de celle-ci.
« Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu. »[18] Comprendre que Dieu est éternel, c’est immédiatement lui vouer un amour éternel. Ainsi, « l’amour intellectuel de Dieu qui naît du troisième genre de connaissance est éternel. »[19]
Il est capital de ne pas mésinterpréter le texte : ce que Spinoza affirme est assez clair : c’est parce que je connais que j’aime Dieu. Mieux, l’amour pour Dieu est le résultat de la quête cognitive achevée par le troisième genre, si bien que la finalité éthique n’est autre que l’accomplissement de la connaissance ; ainsi que le déclare avec justesse Matheron, « le Souverain Bien, loin d’avoir seulement pour condition nécessaire la connaissance vraie de Dieu, se définit tout entier par elle ; la béatitude, c’est la joie de comprendre Dieu (…). »[20]
Il est capital de comprendre ici comment la joie est pleinement active en tant qu’elle est l’acte même de connaissance et de compréhension divins, elle est ce passage cognitif qui a mené à Dieu. Matheron a pleinement raison d’insister sur le fait que le souverain bien n’est autre que la connaissance totale de Dieu par laquelle il m’est donné de l’aimer. Autrement dit, le souverain bien est à la fois un accomplissement du processus cognitif et la totalité de celui-ci ; la nature géométrique de l’Ethique veut que la béatitude soit constituée de l’entièreté des propositions qui l’ont générée. Dès lors, la joie de comprendre Dieu n’est autre que l’entièreté des propositions qui ont mené à cet état.
b) L’amour de Dieu : du génitif objectif au génitif subjectif et l’hésitation spinozienne
Si la joie de comprendre Dieu est précisément le fait de le connaître, il serait pleinement logique que Dieu s’aime lui-même dans l’exacte mesure où il se connaît. C’est précisément ce que déclare Spinoza dans le livre V :
« L’Amour intellectuel (Amor intellectualis) de l’Esprit envers Dieu est l’Amour même de Dieu, dont Dieu s’aime lui-même, non en tant qu’il est infini, mais en tant qu’il peut s’expliquer par l’essence de l’Esprit humain, considéré sous l’aspect de l’éternité (sub specie aeternitatis), c’est-à-dire, l’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est une partie de l’Amour infini dont Dieu s’aime lui-même. »[21]
Dans une certaine mesure, eu égard à la logique générale de l’ouvrage, il est tout à fait nécessaire que Dieu s’aime dès lors qu’il se connaît ; mais un point demeure obscur : pourquoi Spinoza parle-t-il encore d’amour ? L’amour, on s’en souvient était une cause extérieure accompagnant une joie. Or, il est ici manifeste que Dieu est cause de sa joie, que cela suffit à l’aimer. En somme, Dieu ne peut être que aimé par l’homme (et par lui-même) puisqu’il ne lui est plus extérieur ; mais dans ce cas, pourquoi est-ce encore de l’amour, puisque la cause n’est plus extérieure ? On aurait pu croire que Spinoza aurait, entre temps, changé de définition de l’amour ; mais il n’en est rien, l’amour du livre V est toujours une cause extérieure accompagnant une joie. Comment comprendre cela ? Je partagerais volontiers l’interprétation d’Alquié selon laquelle les indécisions finales, voire les hésitations du livre V témoignent bien de la « juxtaposition de deux doctrines différentes, résultant elles-mêmes de deux exigences opposées »[22] : Spinoza n’a pas pu ni su trancher entre le Dieu impersonnel qu’il appelait de ses vœux, ce fameux Deus sive natura et le Dieu personnel, hérité de la Bible et de sa culture personnelle. De là cette indécision entre un Dieu pleinement immanent, et un Dieu qui conserve quelque chose de la transcendance, indécision qui se retrouve pleinement entre la nécessité de faire de l’amour une cause immanente, et la définition même de l’amour qui suppose l’extériorité de la cause.
c) Spinoza et Heidegger
Quoi qu’il en soit, si l’amour intellectuel est pleinement amour, il doit nécessairement être joie, puisque l’amour est, ne l’oublions, pas une forme particulière de la joie. Cette joie active qui prend la forme de l’amour intellectuel au sein de la béatitude, telle semble être la seule forme possible de réalisation de la joie comme activité, au cours du projet de l’Ethique. Autrement dit, l’amour intellectuel comme seule forme possible de joie active revêt un caractère d’authenticité, comme si, somme toute, les formes précédentes de joie étaient frappées d’un caractère inauthentique : toute la passivité qui grève les joies du livre III résulte de quelque chose comme la finitude même, comme la limitation nécessaire des perfections, du point de vue de leur cause. Si bien que je serais tout à fait enclin à suivre l’interprétation brillante de Jean-Marie Vaysse, fort bien résumée en un bref article, et que l’on pourrait exprimer, avec lui, en ces termes : « La joie éthique ne serait ainsi qu’un autre nom pour dire ce que Sein und Zeit appelle angoisse. De même que chez Heidegger l’angoisse est la seule tonalité affective authentique, la joie-béatitude est chez Spinoza le seul affect qui ne soit plus une passion (…). »[23]
Si Vaysse compare, avec raison, l’angoisse heideggerienne à la joie active spinozienne accomplie au sein de la béatitude, c’est que, dans les deux cas, il y va de la liberté. L’angoisse est précisément ce qui met le Dasein devant son « être libre pour… » tout comme la béatitude est le lieu de la liberté accomplie. Tout se passe comme si, chez Spinoza et Heidegger on ne vivait pleinement qu’au moment précis où s’ouvrait devant nous cette immensité, ce gouffre de la liberté absolue, bref ce moment où l’on quittait la conscience. Il n’y a d’accomplissement que lorsque l’objet cesse d’être objet, il n’y a de joie véritable que lorsque nous sommes à nous-mêmes notre propre objet de joie, que lorsque Dieu que nous aimons, nous aime parce qu’il se reconnaît en nous. Il n’y a d’activité, en somme, que lorsque la conscience se fait passive, que lorsque la conscience n’a plus d’objet face à elle.
« Joie, joie, joie », en définitive, ne prend tout son sens qu’au terme de la quête intellectuelle qui s’achève dans la béatitude, où la liberté pleine et vécue ouvre sur l’incommensurable, l’infini béat de la vie en Dieu.
Conclusion
La question de la joie apparaît, au terme de ce bien trop bref article, dans toute sa difficulté : il n’y a de joie active, et donc authentique, véritable, pleinement vécue que dans la béatitude, c’est-à-dire dans ce stade que peu de lecteurs, selon toute vraisemblance, ont connu et expérimenté.
De toute évidence, la joie action aurait dû se réaliser dans le deuxième genre de connaissance, et plus précisément lorsque Spinoza avait énuméré la consistance de la générosité, de la force d’âme, de la fermeté, etc. Toutes ces actions engendraient des passages menant vers une plus grande perfection. Les causes étaient ici adéquates, internes, et pourtant Deleuze crut bon de déporter l’accomplissement réel des joies actives au sein du troisième genre de connaissance, en ce sens que la substitution de la nécessité interne à la passivité externe générait la liberté divine, du livre V. Ce mouvement est légitime, puisqu’au fond, c’est celui qu’observe Spinoza ; toutefois, on ne peut que déplorer l’absence réelle de compréhension de la nécessité du passage, et, plus profondément de la raison pour laquelle le deuxième genre est lacunaire ou insuffisant quant à l’obtention de la joie active.
Pourquoi ce saut que rien ne laissait préfigurer ? Je crois que somme toute il est très difficile d’admettre qu’une cause adéquate suffirait à rendre active une joie, puisque cela supposerait que l’âme, se contemplant elle-même, parviendrait à faire de la joie une action. Et cela, Alquié a pleinement raison, c’est incompréhensible, ce qui me ferait dire que Deleuze n’a pas compris non plus ce processus, ce qui explique sa relative impasse quant à l’explication de celui-ci. Dès lors, il est directement passé à la question de la béatitude, laquelle présente l’incommensurable mérite d’être clairement exposée par Spinoza : il va de soi que dans la béatitude, toute joie ne sera qu’active.
Seulement, au moment même où la logique du système est davantage compréhensible, la possibilité de l’expérimenter s’écroule ; si nous pouvions tous expérimenter le deuxième genre de connaissance, il est fort peu crédible que nous soyons en mesure de parvenir au troisième, si bien que si les joies actives ne s’accomplissent véritablement que dans la béatitude, nous sommes pratiquement condamnes à ne jamais les connaître.
En somme, le scepticisme à l’égard de la pensée spinoziste que je reprends à Alquié provient d’un problème capital, et qui court tout au long de l’Ethique : le passage du deuxième au troisième genre. Est-il réellement possible, à l’aide d’un enchaînement géométrique, de quitter le point de vue du deuxième genre, et de plonger au sein du troisième, c’est-à-dire dans l’infinie liberté de la béatitude ? Avec Alquié, j’avoue que je ne le crois pas, et je préfère, pour finir avec mes habituelles lubies, la dialectique hégélienne pour résoudre les contradictions réelles que les mathématiques, fussent-elles géniales, ne sauront jamais résorber.
Elise m’a fort gentiment proposé de disserter sur la notion de « joie » chez Spinoza ; je dois avouer que je fus initialement rétif à une telle proposition, d’une part parce que mes compétences en matière de Spinoza sont plus que limitées, et parce que, d’autre part, Spinoza est désormais accolé à un infamant 4 obtenu à un commentaire de texte à l’agrégation…
Mais, chacun ici le sait, nul ne saurait rien refuser à Elise, et je me suis vu dans l’obligation presque inconsciente d’accepter une telle offre. J’en profite pour te remercier, chère Elise, de m’accueillir sur ton blog, et de m’avoir donné l’occasion de travailler, fût-ce fort imparfaitement, ces textes qui me demeurent tant obscurs.
Je le répète, Spinoza est à mes yeux incompréhensible. Incompréhensible parce que contrairement aux Méditations de Descartes, par exemple, je ne suis jamais parvenu à reproduire moi-même l’itinéraire spirituel proposé par Spinoza, afin de parvenir à la béatitude. Car, il ne faut jamais l’oublier, Spinoza nous convie, dans l’Ethique, à la béatitude ; qui a refermé l’ouvrage doit avoir, sous peine de mécompréhension, atteint une béatitude éternelle. « C’est en ce sens, écrit Alquié, qu’il se sépare de tous les philosophes occidentaux de l’époque moderne. On n’a pas assez insisté sur cette différence, pas assez averti, au début de toute étude consacrée à Spinoza, que nous quittons avec lui le terrain sur lequel Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant se sont placés. Or, c’est de cette différence que provient l’incompréhensibilité de l’Ethique. »[1]
A la suite d’Alquié, donc, je le dis clairement : je ne comprends pas Spinoza.
La question de la joie spinoziste est un concept central de l’Ethique, un pivot même pourrions-nous dire, mais un concept que, au même titre que l’Ethique en son entier, je ne comprends pas. Pourtant, si l’on regarde les définitions, la joie est on ne peut plus limpide : une passion par laquelle l’âme passe à une perfection plus grande. Cette notion de « passage » est capitale, ainsi que je tenterai de le démontrer ultérieurement ; il est essentiel de comprendre que la joie n’est pas un état, mais un passage, une transition, et en aucun cas, comme le remarque Delbos[2], une perfection en acte, comme on en trouve tant chez Aristote ou dans la scolastique.
L’essentiel du problème amené par la joie au sein du système spinoziste réside dans sa nature : bien que joie, elle est définie comme passive, ce qui grève d’avance la possibilité même d’une joie totale : l’extériorité de la cause sera toujours source de tristesse, laissera toujours la porte ouverte à une titillatio coquine qui viendra nous taquiner. Une joie pleinement vécue serait dès lors une joie active, une joie que l’âme connaîtrait en se contemplant elle-même ; mais une telle possibilité, cela est évident, engage la totalité du système spinoziste, pour être accomplie. Autrement dit, la joie charrie avec elle l’entièreté de l’Ethique, en ce que, ainsi que je vais tenter de le montrer, elle suppose le passage – le saut – dans la béatitude et la liberté divine pour être véritablement vécue et expérimentée. C’est à la possibilité d’un tel saut qu’est consacré le présent article.
I°) Sens et nature de la joie
a) La joie est un affect
La première occurrence de la « joie » dans l’Ethique se situe fort significativement dans un scolie, plus précisément dans la scolie de la proposition 11 du livre III. Ces quelques indications topographiques délivrent des renseignements de toute première importance quant à la nature de la joie spinoziste ; tout d’abord, sa localisation au sein du livre III témoigne clairement du fait que la joie est un affect, c’est-à-dire une affection du corps, susceptible d’augmenter ou de diminuer :
« Par affect, (per affectum), j’entends les affections du Corps, qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient, la puissance d’agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections. Si donc nous pouvons être cause adéquate d’une de ces affections, alors par l’Affect j’entends une action ; autrement une passion[3]. »
Par cette définition capitale, il nous est ainsi donné une alternative et une seule : si la joie relève des affects, alors elle est soit passive, soit active. Pour que la joie soit un affect actif, encore faut-il que nous soyons cause adéquate, c’est-à-dire cause « dont l’effet peut se percevoir clairement et distinctement par elle. »[4] Dans tous les autres cas, la joie relèvera de la passivité.
Par ailleurs, Spinoza définit l’affect par un critère de variabilité, d’augmentation et de diminution, si bien que là encore, il faudra que Spinoza définisse la joie par cela même qui se trouve susceptible d’une oscillation.
Enfin, Spinoza prend la peine de distinguer l’affection qui a une efficace sur le corps de l’idée de cette affection, qui aura nécessairement une efficace sur l’Esprit, et non sur le corps.
Savoir que la joie est localisée dans le livre III, et donc dans la section consacrée aux affects, nous délivre donc d’emblée trois renseignements majeurs avant même que nous n’ayons abordé la définition de la joie en tant que telle :
1) La joie peut être active ou passive
2) La joie est un processus d’augmentation ou de diminution.
3) La joie pourra se rapporter au corps et / ou à l’esprit.
Ainsi que nous l’annoncions précédemment, c’est la proposition XI du livre III qui introduit la joie comme moment capital de la réflexion spinoziste :
« Toute chose qui augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance d’agir de notre corps, l’idée de cette même chose augmente ou diminue, aide ou contrarie, la puissance de penser de notre Esprit. »[5]
Je ne reprendrai pas la démonstration de cette proposition, mais je vais essayer d’en montrer les implications : si l’Esprit peut être aidé ou contrarié, si l’Esprit est susceptible de connaître de telles variations quant à sa puissance, c’est qu’il existe des passages, des transitions, au sein même de l’Esprit, qui lui font connaître de telles variations. Le passage d’un état inférieur à un état supérieur, pour l’esprit, sera qualifié de « joie », tandis que l’inverse, c’est-à-dire la dégradation de l’état supérieur vers l’état inférieur sera qualifié de « tristesse ». Pour autant, l’Esprit qui recherche la plénitude ne recherche en rien ces instabilités permanentes, qui le font osciller de la contrariété à la satisfaction, et de la satisfaction à la contrariété ; l’oscillation même du mouvement de la joie et de la tristesse témoigne qu’il s’agit là d’une passion, que l’Esprit subit, et en aucun cas d’une action.
« Par Joie (Laetitiam) j’entendrai donc, dans la suite, une passion par laquelle l’Esprit passe à une plus grande perfection. Et, par Tristesse (Tristitiam), une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. »[6]
b) La joie est transitio
Le premier résultat capital quant à la nature de la joie est ici clairement établi : la joie et la tristesse, loin d’être des états stables, prennent la forme de passages, de transitions, passages qui portent en eux le fait qu’il s’agit de phénomènes passifs, où l’esprit pâtit de son instabilité affective, et non de phénomènes actifs où l’Esprit déciderait de se perdre dans une oscillation sans fin. Toutefois, la troisième condition énoncée par Spinoza dans le cas de l’affect portait sur le rapport de celui-ci non seulement à l’esprit, mais aussi au corps ; or, jusqu’à présent, la joie s’est cantonnée clairement à une oscillation de l’Esprit, sans que le corps ne trouve de raison pour intervenir. C’est ici que la rigueur spinoziste entre en jeu, et impressionne par sa cohérence : le corps, chez Spinoza, est clairement défini comme l’ « objet de l’Esprit », si bien que l’Esprit ne connaît jamais que les affections du corps[7]. Si, donc, l’Esprit perçoit ces passages, ces transitions que sont la joie et la tristesse, alors il perçoit nécessairement en même temps les affections du corps qui y correspondent. Si bien que l’on obtient le résultat suivant : la joie et la tristesse, en tant qu’elles se rapportent à l’Esprit, relèvent nécessairement du corps tandis que si elles se rapportent au corps, elles ne sont pas nécessairement perçues par l’Esprit.
Cette disjonction où tout ce qui est perçu par l’Esprit relève du corps, tandis que tout ce qui relève du corps ne se rapporte pas nécessairement à l’Esprit est magnifiquement exprimée dans la suite du scolie :
« De plus, l’affect de Joie, quand il se rapporte à la fois à l’Esprit et au Corps, je l’appelle Chatouillement ou Allégresse (Titillationem vel hilaritem) ; et l’affect de la Tristesse, Douleur ou Mélancolie. »[8]
Le caractère simultané rendu par la séquence « quand il se rapporte à la fois …» est ici fort significatif ; il n’est pas systématique que la joie et la tristesse concernent à la fois l’esprit et le corps, ce qui signifie, en clair, que la joie et la tristesse ne se rapportent pas toujours à l’esprit puisque si joie et tristesse étaient nécessairement des variations spirituelles, l’objet de celles-ci serait corporel, auquel cas Spinoza ne prendrait pas la peine de préciser l’éventualité des cas où joie et tristesse se rapportent à la fois à l’Esprit et au corps.
Cette clarification sémantique et conceptuelle de la joie et de la tristesse nous a ainsi livré deux résultats et une promesse.
Tout d’abord, la joie et la tristesse ne sont pas des états mais des devenirs, des transitions (Spinoza emploie le terme latin de transitio), ce qui signifie que la joie et la tristesse constituent des passages au sein de l’esprit et du corps. Il est également indubitable que ce sont des passions, que subissent le corps et l’Esprit, lesquels se retrouvent ballottés de part et d’autre par cette incessante oscillation des affects. Toutefois, de cette situation instable naît une promesse : de même qu’il est possible de quitter les états de contrariété pour atteindre la satisfaction dans un mouvement que Spinoza nomme « joie », de même il semble possible de dépasser cette passivité déplorable pour asseoir une joie active ; telle est la promesse à laquelle nous convie Spinoza. « Le projet pratique de l’Ethique, écrit Jean-Marie Vaysse, qui est de montrer comment on peut passer de la servitude passionnelle à la liberté de la raison, est donc indissociable d’une théorie de l’affectivité expliquant comment aller de la tristesse à la joie et des passions aux actions. »[9]
c) Un cas particulier de la joie : l’Amour
Aller de la tristesse à la joie, et de la passion aux actions, tel est le programme qui nous est imparti. Il va de ce fait nous falloir trouver une situation où la joie ne soit pas fondamentalement passive ; or, une telle quête est d’emblée impossible ou contradictoire car ce serait remettre en cause le résultat précédent, à savoir la nature passive de la joie et de la tristesse. Spinoza est donc logiquement acculé à dériver l’objet de la joie, ou plutôt de placer aux côtés de la joie par essence passive, quelque chose de l’ordre de l’activité. Ce à quoi va donc se livrer Spinoza, c’est à une définition d’un cas particulier de la joie, celui où celle-ci se trouve accompagnée d’une cause extérieure. Autrement dit, au lieu que l’on en reste à une joie comme passage d’un état interne soumis à la passivité, on assiste ici à une causalité externe accompagnant la joie : cette joie accompagnée d’une cause extérieure, Spinoza lui donne un nom précis : l’amour.
« l’Amour n’est rien d’autre qu’une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure, et la Haine, rien d’autre qu’une Tristesse qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. »[10]
Ce scolie spinoziste a deux implications majeures :
1) L’amour n’a de sens que vis-à-vis d’une extériorité. Il n’y a d’amour que si la joie parvient à être accompagnée de cette cause extérieure. Il n’est pas possible de soutenir qu’il s’agit ici d’un amour de soi.
2) Pour autant, l’amour demeure une modalité dérivée de la joie, et demeure à ce titre très certainement passif. Il ne s’agit en rien d’une relation biunivoque entre deux êtres, l’amant et l’aimé, mais d’un terme synthétique, l’amour, où prime très nettement l’amant, puisque son amour est abordé à partir de sa joie propre. Nulle réciprocité dans l’amour spinoziste, il ne s’agit pas de penser l’amour entre deux êtres, mais de comprendre comment cette cause extérieure accompagnant la joie peut contribuer à l’obtention du salut pour un individu, et non pour le couple.
L’amour, somme toute, par lequel la joie est accompagnée d’une cause extérieure ne résout en rien le problème de la passivité de la joie ; de fait, Spinoza poursuit ses propositions en qualifiant l’amour et la haine par des termes nettement passifs.
« Qui imagine affecté de Joie ou bien de Tristesse ce qu’il aime sera lui aussi affecté de Joie ou bien de Tristesse ; et l’un et l’autre affect sera plus ou moins grand dans l’amant, selon que l’un et l’autre est plus ou moins grand dans la chose aimée. »[11]
Outre qu’il y va toujours de l’amant, et jamais de l’aimé, ce qui se comprend parfaitement dans la logique spinoziste du salut, l’affect domine sans partage, ce qui signifie clairement que la passivité domine dans l’exacte mesure où la cause extérieure ne saurait être cause adéquate.
II°) Y a-t-il des joies actives ?
a) L’interprétation de Gilles Deleuze
Il semble à ce stade que nulle possibilité de fonder une joie active ne soit donc possible ; l’amour lui-même porte en lui son lot de passivité, précisément parce que la cause qui accompagne la joie passive demeure extérieure, et ne saurait devenir adéquate ; disons-le franchement, Spinoza ne parle pratiquement jamais de « joie active », ce serait là une parfaite contradictio in adjecto. Pourtant, un commentateur, et pas des moindres, a tenté d’interpréter ce monstre hybride de la joie active, afin de remédier à ce cette aporie de la joie passive, dans le but de tenter un saut vers une « joie active », locution qui n’apparaît pas comme telle dans l’Ethique. Ce commentateur est évidemment Gilles Deleuze, dont je vais tenter de restituer le raisonnement : la question qu’il pose est fort simple au demeurant : est-il possible de transformer la cause extérieure de l’amour en cause adéquate ? Dès lors qu’il y a joie, il y a augmentation de la puissance, l’augmentation étant même confondue avec le passage induit par la translatio de la laetitia. S’il y a action joyeuse, elle résulte d’une cause interne. « Quand Spinoza suggère que ce qui convient avec la raison peut aussi en naître, il veut dire que toute joie passive peut donner lieu à une joie active qui s’en distingue seulement par la cause. »[12]
Il faut ici être très ferme : jamais Spinoza ne dit explicitement qu’il existe des joies actives, et du reste, le phrasé de Deleuze ne dit pas autre chose : quand Spinoza dit x, il faut entendre y. Or, si Spinoza dit effectivement x, il ne dit pas textuellement y, y étant la fameuse « joie active »…
La thèse de Deleuze, parce qu’elle est célèbre et intéressante mérite d’être étudiée dans toute sa force interprétative : peut-on envisager une joie formée par une cause adéquate, interne, une cause dont les effets seraient immédiatement intelligibles puisque immanents ? A mieux y regarder, la question que pose Deleuze n’est pas furieusement révolutionnaire : elle ne fait qu’examiner la possibilité décrite par Spinoza lui-même d’un affect actif, en tant que nous en serions cause adéquate[13]. Toutefois, la voie qu’il propose pour y répondre s’avère assez originale ; pour que l’on ait une cause adéquate, il faut partir d’un raisonnement juste, nécessairement fondé sur des notions communes, seules prémisses valables aux yeux de Spinoza. Si nous voulons obtenir une joie active, il nous faut de ce fait déterminer quelles sont les notions communes constituant le point de départ du raisonnement, lesquelles notions communes nous feront comprendre les rapports de convenance et de disconvenance.
b) L’éphémère argument des notions communes
De toute évidence, les notions communes se rapportent à ce que Spinoza nomme le « deuxième genre de connaissance », c’est-à-dire à la raison[14]. Or, nous dit Deleuze, dans le deuxième genre de connaissance, caractérisé par les notions communes, nous en restons aux notions inadéquates d’affection, elles ne deviendraient adéquates que dans le troisième genre. Cet argument est à la fois violemment faux, en ce qu’il occulte la caractéristique majeure de la connaissance du deuxième genre qui consiste justement à avoir des idées adéquates des propriétés des choses, et de mauvaise foi car il consiste à dissimuler totalement une question spinoziste posée par la nature même de la joie que je vais détailler sous peu.
Au fond, la thèse de Deleuze est simple à comprendre : la joie ne devient véritablement active que dans la liberté divine, donc dans la béatitude où, nous dit Deleuze, « procédant de l’idée de nous-mêmes telle qu’elle est en Dieu, nos joies actives sont une partie des joies de Dieu. »[15] Il n’y aurait donc de joies actives que dans le cadre de la béatitude, donc à l’issue de la cinquième partie de l’Ethique dans l’exacte mesure où la béatitude se définit justement comme la « possession d’un amour actif tel qu’il est en Dieu. »[16] Outre la terminologie assez flottante qu’emploie Deleuze, passant indifféremment de la joie active à l’amour actif, il s’agit de bien saisir le nerf de la pensée deleuzienne : pourquoi le deuxième genre de connaissance ne suffirait-il pas à assurer la possibilité d’une joie active, puisque ledit deuxième genre se définit justement par la cause adéquate ?
c) Du deuxième au troisième genre de connaissance
La réponse de Deleuze à la question précédente est surprenante : parce que Dieu, dans le deuxième genre, puisqu’il ne pense pas par notions communes, ne peut ressentir de joie active, il nous faut somme toute renoncer au deuxième genre de connaissance et plonger dans le troisième. Autrement dit, selon Deleuze, la joie active véritable ne pourrait être que celle dont Dieu est capable, et cela infirme immédiatement la possibilité de celle-ci au sein du deuxième genre, ce qui expliquerait du reste l’insolente absence de la locution « joie active » avant le cinquième livre de l’Ethique.
Une telle thèse eût été acceptable si, dans l’économie générale de sa thèse, Deleuze avait respecté deux conditions :
1) si Deleuze n’avait pas entamé son raisonnement par la nécessité d’une cause adéquate qui semblait somme toute s’arrêter au deuxième genre de connaissance.
2) Si Deleuze, moins aveuglé par sa fascination de l’immanentisme, avait reconnu une certaine hésitation spinozienne.
Il est tout à fait vrai que selon Spinoza, le troisième genre de connaissance naît du second[17] et qu’à ce titre un dépassement des notions communes est envisageable. De surcroît, il est vrai qu’une variation de la joie et de l’amour refait surface dans le cinquième livre : connaître par le troisième genre, nous dit Spinoza, nous donne du plaisir. Mais cela ne nous dit pas pourquoi Deleuze a tant insisté sur la nécessité d’une cause adéquate comme condition nécessaire et suffisante de la joie active, ce qui ne semble pas être finalement le cas aux yeux de Deleuze, ni pourquoi le saut dans la béatitude s’avère indispensable. Tout se passe comme si Deleuze s’était rendu compte en cours de route que la joie active ne se réalisait pas avec les seules causes adéquates du deuxième genre et que, lui-même surpris par cette non-réalisation, il avait occulté l’incompréhensible besoin du saut dans la béatitude pour que celles-ci se réalisent. En somme, pour le dire clairement, si l’on comprend très clairement pourquoi les joies actives se réalisent dans la béatitude, il est incompréhensible qu’elles ne se réalisent pas dans les causes adéquates du deuxième genre, et cette non-réalisation ne nous est guère explicitée par Deleuze alors même qu’il avait annoncé la nécessité de leur réalisation…
III°) Joie active et Amour intellectuel
a) La joie de comprendre Dieu
Nous sommes désormais en plein dans la béatitude et c’est en elle qu’il nous faut quêter des traces de la joie active, comme accomplissement plénier de celle-ci.
« Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu. »[18] Comprendre que Dieu est éternel, c’est immédiatement lui vouer un amour éternel. Ainsi, « l’amour intellectuel de Dieu qui naît du troisième genre de connaissance est éternel. »[19]
Il est capital de ne pas mésinterpréter le texte : ce que Spinoza affirme est assez clair : c’est parce que je connais que j’aime Dieu. Mieux, l’amour pour Dieu est le résultat de la quête cognitive achevée par le troisième genre, si bien que la finalité éthique n’est autre que l’accomplissement de la connaissance ; ainsi que le déclare avec justesse Matheron, « le Souverain Bien, loin d’avoir seulement pour condition nécessaire la connaissance vraie de Dieu, se définit tout entier par elle ; la béatitude, c’est la joie de comprendre Dieu (…). »[20]
Il est capital de comprendre ici comment la joie est pleinement active en tant qu’elle est l’acte même de connaissance et de compréhension divins, elle est ce passage cognitif qui a mené à Dieu. Matheron a pleinement raison d’insister sur le fait que le souverain bien n’est autre que la connaissance totale de Dieu par laquelle il m’est donné de l’aimer. Autrement dit, le souverain bien est à la fois un accomplissement du processus cognitif et la totalité de celui-ci ; la nature géométrique de l’Ethique veut que la béatitude soit constituée de l’entièreté des propositions qui l’ont générée. Dès lors, la joie de comprendre Dieu n’est autre que l’entièreté des propositions qui ont mené à cet état.
b) L’amour de Dieu : du génitif objectif au génitif subjectif et l’hésitation spinozienne
Si la joie de comprendre Dieu est précisément le fait de le connaître, il serait pleinement logique que Dieu s’aime lui-même dans l’exacte mesure où il se connaît. C’est précisément ce que déclare Spinoza dans le livre V :
« L’Amour intellectuel (Amor intellectualis) de l’Esprit envers Dieu est l’Amour même de Dieu, dont Dieu s’aime lui-même, non en tant qu’il est infini, mais en tant qu’il peut s’expliquer par l’essence de l’Esprit humain, considéré sous l’aspect de l’éternité (sub specie aeternitatis), c’est-à-dire, l’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est une partie de l’Amour infini dont Dieu s’aime lui-même. »[21]
Dans une certaine mesure, eu égard à la logique générale de l’ouvrage, il est tout à fait nécessaire que Dieu s’aime dès lors qu’il se connaît ; mais un point demeure obscur : pourquoi Spinoza parle-t-il encore d’amour ? L’amour, on s’en souvient était une cause extérieure accompagnant une joie. Or, il est ici manifeste que Dieu est cause de sa joie, que cela suffit à l’aimer. En somme, Dieu ne peut être que aimé par l’homme (et par lui-même) puisqu’il ne lui est plus extérieur ; mais dans ce cas, pourquoi est-ce encore de l’amour, puisque la cause n’est plus extérieure ? On aurait pu croire que Spinoza aurait, entre temps, changé de définition de l’amour ; mais il n’en est rien, l’amour du livre V est toujours une cause extérieure accompagnant une joie. Comment comprendre cela ? Je partagerais volontiers l’interprétation d’Alquié selon laquelle les indécisions finales, voire les hésitations du livre V témoignent bien de la « juxtaposition de deux doctrines différentes, résultant elles-mêmes de deux exigences opposées »[22] : Spinoza n’a pas pu ni su trancher entre le Dieu impersonnel qu’il appelait de ses vœux, ce fameux Deus sive natura et le Dieu personnel, hérité de la Bible et de sa culture personnelle. De là cette indécision entre un Dieu pleinement immanent, et un Dieu qui conserve quelque chose de la transcendance, indécision qui se retrouve pleinement entre la nécessité de faire de l’amour une cause immanente, et la définition même de l’amour qui suppose l’extériorité de la cause.
c) Spinoza et Heidegger
Quoi qu’il en soit, si l’amour intellectuel est pleinement amour, il doit nécessairement être joie, puisque l’amour est, ne l’oublions, pas une forme particulière de la joie. Cette joie active qui prend la forme de l’amour intellectuel au sein de la béatitude, telle semble être la seule forme possible de réalisation de la joie comme activité, au cours du projet de l’Ethique. Autrement dit, l’amour intellectuel comme seule forme possible de joie active revêt un caractère d’authenticité, comme si, somme toute, les formes précédentes de joie étaient frappées d’un caractère inauthentique : toute la passivité qui grève les joies du livre III résulte de quelque chose comme la finitude même, comme la limitation nécessaire des perfections, du point de vue de leur cause. Si bien que je serais tout à fait enclin à suivre l’interprétation brillante de Jean-Marie Vaysse, fort bien résumée en un bref article, et que l’on pourrait exprimer, avec lui, en ces termes : « La joie éthique ne serait ainsi qu’un autre nom pour dire ce que Sein und Zeit appelle angoisse. De même que chez Heidegger l’angoisse est la seule tonalité affective authentique, la joie-béatitude est chez Spinoza le seul affect qui ne soit plus une passion (…). »[23]
Si Vaysse compare, avec raison, l’angoisse heideggerienne à la joie active spinozienne accomplie au sein de la béatitude, c’est que, dans les deux cas, il y va de la liberté. L’angoisse est précisément ce qui met le Dasein devant son « être libre pour… » tout comme la béatitude est le lieu de la liberté accomplie. Tout se passe comme si, chez Spinoza et Heidegger on ne vivait pleinement qu’au moment précis où s’ouvrait devant nous cette immensité, ce gouffre de la liberté absolue, bref ce moment où l’on quittait la conscience. Il n’y a d’accomplissement que lorsque l’objet cesse d’être objet, il n’y a de joie véritable que lorsque nous sommes à nous-mêmes notre propre objet de joie, que lorsque Dieu que nous aimons, nous aime parce qu’il se reconnaît en nous. Il n’y a d’activité, en somme, que lorsque la conscience se fait passive, que lorsque la conscience n’a plus d’objet face à elle.
« Joie, joie, joie », en définitive, ne prend tout son sens qu’au terme de la quête intellectuelle qui s’achève dans la béatitude, où la liberté pleine et vécue ouvre sur l’incommensurable, l’infini béat de la vie en Dieu.
Conclusion
La question de la joie apparaît, au terme de ce bien trop bref article, dans toute sa difficulté : il n’y a de joie active, et donc authentique, véritable, pleinement vécue que dans la béatitude, c’est-à-dire dans ce stade que peu de lecteurs, selon toute vraisemblance, ont connu et expérimenté.
De toute évidence, la joie action aurait dû se réaliser dans le deuxième genre de connaissance, et plus précisément lorsque Spinoza avait énuméré la consistance de la générosité, de la force d’âme, de la fermeté, etc. Toutes ces actions engendraient des passages menant vers une plus grande perfection. Les causes étaient ici adéquates, internes, et pourtant Deleuze crut bon de déporter l’accomplissement réel des joies actives au sein du troisième genre de connaissance, en ce sens que la substitution de la nécessité interne à la passivité externe générait la liberté divine, du livre V. Ce mouvement est légitime, puisqu’au fond, c’est celui qu’observe Spinoza ; toutefois, on ne peut que déplorer l’absence réelle de compréhension de la nécessité du passage, et, plus profondément de la raison pour laquelle le deuxième genre est lacunaire ou insuffisant quant à l’obtention de la joie active.
Pourquoi ce saut que rien ne laissait préfigurer ? Je crois que somme toute il est très difficile d’admettre qu’une cause adéquate suffirait à rendre active une joie, puisque cela supposerait que l’âme, se contemplant elle-même, parviendrait à faire de la joie une action. Et cela, Alquié a pleinement raison, c’est incompréhensible, ce qui me ferait dire que Deleuze n’a pas compris non plus ce processus, ce qui explique sa relative impasse quant à l’explication de celui-ci. Dès lors, il est directement passé à la question de la béatitude, laquelle présente l’incommensurable mérite d’être clairement exposée par Spinoza : il va de soi que dans la béatitude, toute joie ne sera qu’active.
Seulement, au moment même où la logique du système est davantage compréhensible, la possibilité de l’expérimenter s’écroule ; si nous pouvions tous expérimenter le deuxième genre de connaissance, il est fort peu crédible que nous soyons en mesure de parvenir au troisième, si bien que si les joies actives ne s’accomplissent véritablement que dans la béatitude, nous sommes pratiquement condamnes à ne jamais les connaître.
En somme, le scepticisme à l’égard de la pensée spinoziste que je reprends à Alquié provient d’un problème capital, et qui court tout au long de l’Ethique : le passage du deuxième au troisième genre. Est-il réellement possible, à l’aide d’un enchaînement géométrique, de quitter le point de vue du deuxième genre, et de plonger au sein du troisième, c’est-à-dire dans l’infinie liberté de la béatitude ? Avec Alquié, j’avoue que je ne le crois pas, et je préfère, pour finir avec mes habituelles lubies, la dialectique hégélienne pour résoudre les contradictions réelles que les mathématiques, fussent-elles géniales, ne sauront jamais résorber.
Notes
[1]
Ferdinand Alquié, Le rationalisme de Spinoza, PUF, coll. Epiméthée, 1981, p. 11[2] Victor Delbos, Le Spinozisme, Vrin, 2005, p. 130, sqq.
[3] Spinoza, Ethique, livre III, définition 3, traduction Bernard Pautrat, Seuil 1988, points seuil, 1999, p. 203
[4] Ethique, Livre III, définition 1, op. cit, p. 203
[5] Ethique, Livre III, proposition XI, op. cit., p. 221
[6] Ibid., scolie, p. 223
[7] « L’Esprit ne se connaît pas lui-même, si ce n’est en tant qu’il perçoit les idées des affections du Corps. », in Ethique, Livre II, prop. 23
[8] Ibid.
[9] Jean-Marie Vaysse, Joie, mort, angoisse, in Spinoza et les affects, Groupe de recherches spinozistes, travaux et documents, N°7, Presse Sorbonne, 1998, p. 9
[10] Ethique, Livre III, Prop. 13, scolie, op. cit., p. 227
[11] Livre III, prop. 21, p. 237
[12] Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, Minuit, 1968, p. 253, sq.
[13] Ainsi que nous l’avions montré dans la définition 3 du livre III
[14] « de ce que nous avons des notions communes, et des idées adéquates des propriétés des choses ; et cette manière, je l’appellerai raison et connaissance du deuxième genre. », Livre II, prop. 40, scolie 2.
[15] Deleuze, op. cit., p. 288
[16] Ibid.
[17] cf. Ethique, V, prop. 28
[18] Ethique, V, prop. 32, corollaire, p. 525
[19] Ethique, V, prop. 33, p. 525
[20] Alexandre Matheron, Le Christ et le salut des ignorants, Aubier-Montaigne, 1971, p. 107
[21] Ethique, V, prop. 36, p. 529
[22] Ferdinand Alquié, op. cit., p. 342, sq.
[23] Jean-Marie Vaysse, art. cit., p. 20






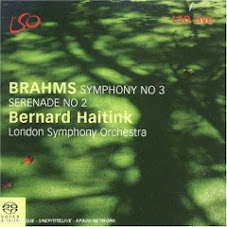









17 commentaires:
Je ne sais pas qui a écrit cet article, mais je le trouve remarquable...Hum...
si tu t'auto-congratules chez moi pour Derrida/Hegel quand ça sera en ligne, gare à toi, Gai Lulu...
mdr
Je ne sais pas qui est ce Gai Lulu qui a écrit ce commentaire mais je le trouve presque plus remarquable encore que l'article du même auteur.
Ecoute, Gai Luron commentateur, à l'évidence c'est un fumiste qui a écrit ce texte: il le dit lui-même, il s'est mangé 4 à l'agrégation, et il a le toupet de venir nous pondre un article sur Spinoza quand même...
Oui, c'est vraiment un scandale. Heureusement qu'il y a des belle lurettes pour recueillir les "sans-pensées" de la philosophie. Vive Belle Lurette !
eh bien, décidément, tu fais une belle chasse anti-deleuzienne...
après Nietzsche, Spinoza.
et encore une fois, lecture à l'emporte-pièce.
sur ta question de la "joie active" qui chez Deleuze serait réservée au 3ème genre de connaissance...
d'abord, oui, je pense que Deleuze essaie de penser en accord avec le système de Spinoza (pour une fois qu'il faut le soutenir dans cette voie, lui le traditionnel rebelle), et de rendre raison du passage à ce troisième genre de connaissance, où je m'affecte moi-même dans une relation directe à Dieu.
donc je trouve cela normal de réserver, en un certain sens, le terme de "joie active", d'affect actif au troisième genre de connaissance.
ensuite, Deleuze ne refuse pas une dimension active par les notions communes, mais distingue celle-ci en préférant le terme d'auto-affection, insistant sur l'autonomie conquise plus que sur une activité en soi.
enfin, le problème du passage du second genre de connaissance au troisième est un des problèmes les plus délicats de Spinoza, n'est-ce pas ? mais à la lecture de Deleuze, je crois que ce passage ne reste pas totalement énigmatique, et que l'on comprend pourquoi une connaissance du second genre n'est pas ultime.
l'auto-affection consiste, par les notions communes, à une certaine maîtrise et compréhension des rapports entre parties extensives. c'est donc une maîtrise des effets et des causes, maîtrise fondamentalement pratique pour Deleuze. mais cette connaissance se situe encore dans un ordre extrinsèque, né des conséquences de l'essence : on est dans l'ordre de l'existence.
alors que le troisième genre de connaissance découle directement d'un rapport des essences, sans passer par l'existence. en cela, je suis véritablement actif, ou "moi-même", dans une communication directe avec l'idée de Dieu.
cette dernière idée a incontestablement une dimension mystique. elle peut demeurer énigmatique. cela tient à Spinoza lui-même. Deleuze essaie d'en rendre compte, à travers notamment des références à des auteurs comme Lawrence, Fitzgerald, que je trouve pour ma part assez suggestives.
Maël,
Il ne s'agissait pas pour moi de taper sur Deleuze, je comprends bien trop mal Spinoza ; la seule chose que j'ai dite consiste en ceci :
- le terme de "joie active" n'apparaît pas dans l'Ethique, et Deleuze l'emploie pourtant comme allant de soi.
- Si l'on suit la logique de Deleuze, on devrait par les notions communes parvenir à cette joie (je n'ai jamais dit que Deleuze refusait les notions communes), ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas de la faute de Deleuze si le moyen par lequel (je dis bien le moyen et non la motivation) on passe du 2nd au 3ème genre de conaissance est obscur ; seulement le problème est que Deleuze ne me semble pas avoir l'honnêteté de dire qu'il n'est pas clair CHEZ SPINOZA comment s'opère le passage, et il y a chez Deleuze, me semble-t-il, une feinte compréhension, à la fois de la motivation et des moyens, précisément parce qu'il n'en parle pas. En somme on comprend pourquoi les notions communes ne sont pas ultimes (mais pas besoin de deleuze pour ça) mais on ne comprend nullement pourquoi :
- la condition logique de la notion commune comme cause des joies actives ne suffit plus. Tu me réponds les notions communes ne sont pas ultimes, ce n'est évidemment pas une réponse, c'est une pétition de principe,puisque c'est déjà présupposer que les joies actives ne peuvent uniquement se rapporter aux notions communes, alors même que Deleuze les qualifie de conditions nécessaires et suffisantes (ce n'est pas le mot qu'il emploie mais c'est le sens). (du reste, tu as mal lu mon texte sur ce point là)
- et si on comprend pourquoi le 3ème genre est parfaitement adéquat pour les "joies actives", on ne comprend pas vraiment pourquoi il est le SEUL adéquat. Je maintiens que Deleuze feint de le comprendre.
C'est d'aileurs une des choses qui m'insupportent au plus haut point chez Deleuze, c'est qu'il considère toujours tout comme intelligible. Il y a un présupposé chez lui en faveur du sens, qui est parfois proprement insupportable. Combien plus me plaît la modestie d'un Alquié qui avoue ne pas comprendre, ou d'un Guéroult qui explique pourquoi telle ou telle démonstration fonctionne ou ne fonctionne pas. Chez Deleuze, il y a paradoxalement un structuralisme interprétatif qui m'est odieux tant il écrase souvent l'ensemble d'une oeuvre à travers un sens global qui s'exprimerait partout.
j'avoue ne pas bien comprendre où se trouve ton problème.
Une joie active est, à strictement parler, impossible à partir des notions communes, celles-ci étant encore soumises au régimes des passions. Au niveau des notions communes, ce sont des "passions maîtrisées", si l'on veut.
Mais que cela ne suffise pas en soi, cela se comprend : c'est une question de modalité de rapport.
Ce que dit Deleuze, c'est qu'il y a deux versants des notions communes :
-les relations de partie à partie, qui entrainent au mieux une "auto-affection" (une "auto-passion', serait plus claire).
-les relations de moi à Dieu, directement, d'essence à essence, qui permettent une réelle activité de la joie.
Mais, point crucial : ce sont des relations contemporaines, simultanées. Autant le passage du 1er au 2ème genre de connaissance peut être chronologique, autant celui du 2ème au 3ème ne l'est pas. C'est en ce sens que Spinoza peut évoquer une "part éternelle" des ces rapports de partie à partie : comme expression des rapports d'essence, relation directe entre le mode individuel et l'idée de Dieu.
je crois que ça peut expliquer ta perplexité. il y a une certaine symétrie entre 2ème et 3ème genre de connaissance : le 2ème est en effet "suffisant", au sens où il pemet le passage à l'expérience de l'éternité (le fameux "nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels"). la maîtrise des passions permet leur "conversion" en une relation directe à Dieu : d'auto-affections, elles deviennent joies actives en tant que participation de mon essence à l'essence divine.
quant au terme "joie active", j'admets que Deleuze le crée simplement à partir du texte de Spinoza. mais c'est parce qu'il répond précisément au problème que tu poses : pourquoi les notions communes ne sont pas suffisantes ? réponse : parce qu'elles permettent qqch de supérieur, à savoir l'expérience de rapports éternels, où mon essence s'affecte elle-même en participant à l'essence divine. ce "passage", cette "conversion" est par exemple évoqué par Spinoza dans l'Ethique, V, 10, si mes souvenirs sont bons. Mais le problème, c'est que Spinoza ne s'attarde pas sur ces affects qui n'en sont plus, qui sont des affects d'essence, donc éternels... il ne les qualifie pas, il parle alors d'amour de Dieu. il y a d'ailleurs tout un jeu lexical en latin autour de cet amour de Dieu, selon mes souvenis encore une fois : "amor dei", "amor erga deum", "amor intellectus dei", selon le degré de "participation" à l'essence divine.
mais ce jeu lexical reste partiel, car il se situe toujours en référence à Dieu (amour de Dieu = joie + Dieu). il conserve le "pôle" divin, mais Spinoza ne qualifie pas la joie elle-même qui accompagne l'amour de Dieu. peut-être parce que cette joie ne peut justement pas être séparée de l'amour de Dieu : elle le concerne directement. mais de façon pédagogique, selon moi (c'est assez comique parce que toi tu y vois une liberté un peu pédante, un peu prétentieuse), Deleuze tente d'expliciter cette joie non passionnelle : il lui donne le nom de "joie active", de manière à bien situer cette "conversion" passion-action, cette sortie du régime extensif des parties.
je sais pas, le cours de Deleuze sur webdeleuze est assez explicite là-dessus...
Tout d'abord, ce n'est pas "mon" problème, c'est le problème de quiconque lit Spinoza, de Delbos, Moreau, Alquié, Guéroult,etc.
Ensuite, tu ne réponds absolument pas à la question posée pour la bonne raison qu'il s'agit là d'un impossible dilemme. Il n'est pas convenable de répondre en disant : les notions communes sont insuffisantes parce qu'elles sont insuffiantes.
Le problème de Spinoza dans le cas très précis évoqué, et qui d'ailleurs se retrouve dans ta pétition de principe, consiste à dire qu'il faut admettre le troisième genre de connaissance pour comprendre l'insuffisance du précédent. Mais cela est inadmissible dans le cadre d'un raisonnement géométrique,ça se comprend aisément.
On ne peut pas faire abstraction du raisonnement géométrique, on ne peut pas faire comme si Spinoza résonnait par récurrence, ce serait certes pratique, mais totalement irreponsable. (il est vrai que l'étude du géométrisme spinoziste n'est guère le souci majeur de ton idole)
Par ailleurs, je m'étonne tout de même de ta lecture deleuzienne ; il dit explicitement que les notions commune sont des idées s'expliquant formellement exprimant matériellement l'idée de Dieu comme cause efficiente. En ayant une telle définition de la notion commune, il en déduit logiquement qu'en découlent des idées adéquates dont le sentiment est parfaitement actif. Il insiste même sur le caractère auto-causal qui élimine la passivité. Du reste il a raison. De ce fait, ainsi que le note Alquié (et que le confirme Moreau dans ses cours), il n'est pas géométriquement normal que l'on doive ajourner la joie active même s'il se comprend A POSTERIORI qu'elle se situe dans la béatitude. Mais le géométrisme n'est pas un science de l'a posteriori, ça se comprend quand même !
"mon" problème (pfff) est donc que la logique du système géométrique est ici brisée et que pour "comprendre" (mais le terme est faux) la raison de l'insuffisance du 2ème genre, on a quitté la géométrie, ce qui est dramatique.
ok ok, on va se calmer.
quand j'ai dit "ton" problème, je parlais de toi/deleuze, sur la joie active, problème qui n'a sans doute pas accaparé gueroult ou moreau.
ensuite, écoute, je conçois bien la vigueur du problème que tu poses. cette différence modale dans l'activité, activité-notion commune, activité-béatitude, est problématique.
alors, moi, sous l'influence de mon idole Gilles Deleuze, je m'en sors ainsi : en ne faisant pas du troisième genre de connaissance un "plus", a posteriori, qui viendrait donner un contenu à une réelle activité.
comme tu le dis, une notion commune implique une activité.
mais moi, je m'en sors en considérant une différence de régime entre 2ème et 3ème genre de connaissances : régime temporel, régime éternel.
L'activité et la joie des notions communes se voit métamorphosées dans la connaissance intuitive. difficile à comprendre ? oui, je serais d'accord, d'où un "mysticisme" spinoziste. ms entre l'amour des notions communes et l'amour de Dieu, il y a une différence de nature.
donc, ces considérations me font refuser tes oppositions complémentaires 2ème genre/3ème genre. le 2ème genre se suffit à lui-même, contrairement au 1er.
voilà ce que j'ai à dire sur Spinoza, je ne tiens pas à continuer plus loin, d'abord parce que je n'ai pas lu Gueroult ni Moreau ni Delbos. et mes souvenirs de l'année dernière sont paresseux.
donc j'admets les difficultés que tu poses, et moi je trouve qu'il y a une autre façon de poser le problème, de façon à ce que celui-ci ne soit plus "dramatique"
Mouais...
Evidemment, quand on est face à un problème, soit on essaye de le résoudre, en acceptant, le cas echéant, d'échouer, soit on le déclare inepte et on le contourne. La seconde option est certes plus confortable.
Je note quand même cette formidable "différence de nature" que tu relèves, en plein dans un système immanentiste, qui procède de façon géométrique. c'est assez merveilleux quand même !
Arrête toi là si tu le souhaites, je ne faisais que répondre aux objections que tu avais initiées.
héhé. ok, je remets ça, parce que ce ton était trop railleur pour me satisfaire.
tu bondis très vite sur ma "différence de nature", sous prétexte que le système de Spinoza serait immanentiste... Mais il s'agit ici de différence de nature entre des modes de connaissance. Tu ne peux donc pas refuser que cette "nature", a ici un sens plus relâché. Il y a bien une différence de "nature" entre le 1ere et le 2ème genre de connaissance, non ?
ici "nature" n'est donc pas entendu au sens strictement spinoziste, physique : ce sont bien les mêmes modes, la même substance dont il s'agit dans les deux genres de connaissance.
Le mot "nature" implique simplement qu'il ne s'agit pas d'une différence de degrés. On ne passe pas du 2ème genre au 3ème genre de connaissance par un progrès continu : il y a un saut, une conversion, une mutation.
Donc, ton recours à l'immanentisme est un peu naïf : qualifier le système spinoziste d'immanentiste pose forcément problème, quand une substance diffère en nature de ses modes en dehors desquels elle n'existe pourtant pas.
et quid d'une distinction entre l'essence et l'existence ? est-ce immanentiste, cela ?
enfin, ta fidélité au géométrisme spinoziste semble un peu forcé. Faut-il faire de Spinoza un géomètre forcené ? quel statut a la méthode géométrique dans son texte de l'Ethique, seul ouvrage de lui à utiliser cette méthode ? n'y a-t-il pas des ruptures claires dans l'Ethique, notamment à partir du livre V, où on entre clairement dans le régime de l'éternité ? Comment la méthode géométrique rend-elle compte continument de cela ?...
Fin sur un registre perso : cet argument sempiternel comme quoi "oui, Spinoza a promis la béatitude, alors, elle est où cette béatitude ?" me semble juste benêt. que l'ontologie spinoziste soit corrélée à une éthique, voilà peut-être la véritable promesse spinoziste, et non pas celle d'un christ philosophique promettant le bonheur à coup sûr. que la connaissance du second genre soit déjà corrélée à une sagesse, c'est peut-être plus important que des arguments de piailleurs contents d'avoir trouvé une promesse non tenue.
je sais bien que ce genre de commentaire va te déplaire fortement. je n'ai pas ton adoration pour le rationalisme. je considère que les vues deleuziennes ont une fécondité tenant aux objections soulevées plus haut, en recherchant les points d'intérêt chez Spinoza, plutôt que de commenter la cohérence en béton de son système de A à Z.
PS : notamment, ses suggestions concernant cete béatitude concernant Spinoza par rapport à Lawrence ou Fitzgerald sont vraiment fortes... tu as lu Lawrence ? (yeeeah, ok, c'est plus Spinoza, c'est plus Martial Gueroult, c'est plus Vincent Delbos... ok.)
Mister Maël,
Quelle surprise de te retrouver à nouveau malgré l'annonce fracassante de ton départ. Je m'en réjouis.
Tu ne devrais pas te formaliser sur la question de la différence de nature, ce n'est pas toi que je raillais, ni personne d'ailleurs ; c'était juste une boutade, comme le laissait entendre le ton enjoué de ma remarque.
Je me réjouis que tu te réjouisses tellement de lire Lawrence ; je ne l'ai pas lu en effet, non pas par principe ni par a priori mais par pure contigence ; mais je le lirai car, de toute évidence, c'est un auteur qui permet à ses lecteurs de se la jouer cools et moi aussi je pourrai dire fièrement à mes amis "yeeeeeaaaaaaah ! t'as lu Lawrence, hein ? Yeeeeaaaah ! Non ? héhéhéhé !"
Je suis ravi d'apprendre que l'éthique est le seul livre de spinoza écrit selon l'ordre géométrique. Il m'avait semblé que les principes métaphysiques de la pensée de descartes l'étaient également, mais j'ai dû mal lire.
Il m'avait semblé également qu'obtenir le salut n'était pas une mince affaire et que c'était la raison pour laquelle Spinoza déployait une argumentation de type géométrique et qu'en ne reproduisant pas l'ordre géométrique on n'arrivait pas au salut, dessein unique de l'Ethique, quoi que tu en penses. Moi, pauvre lecteur cherchant le salut, j'ai tenté de reproduire l'ordre géométrique et à la fin je n'ai pas été sauvé ; je me suis donc bêtement dit que soit le système était juste mais qu'il était faux de pouvoir atteindre le salut par la géométrie, soit qu'il y avait un problème à un ou plusieurs endroits, d'un point de vue géométrique. Et puis finalement je me suis dit que l'un n'empêchait pas l'autre.
Je ne me réjouis nullement de la promesse non tenue de Spinoza, j'admire nombre de ses propositions, mais est-ce faire preuve de rationalisme buté que de rester fidèle à la méthode employée, à savoir la géométrie ? Spinoza est lui-même rationaliste, et cherche à asseoir le salut par la raison géométrique ; la moindre des choses quand on lit l'Ethique, c'est d'employer sa propre méthode. Le reste n'est que divagations.
Enfin, tu notes - avec fausseté mais peu importe ici - que seule l'éthique est écrite en langage géométrique ; mais seule l'éthique cherche à atteindre le salut, et pour cette raison même se retrouvent liés le salut et la méthode géométrique. Ne pas voir cela, c'est tout manquer à mon sens, à la fois la richesse inouïe et la difficulté foncière d'admettre le spinozisme comme valable.
Je me demande du reste quelle est ta démarche : sauver l'interprétation de Deleuze, dire que Spinoza n'est pas rationaliste ou dire que l'essentiel de l'éthique réside dans une éthique du désir ? J'ai parfois l'impression que tu as lu spinoza parce que deleuze a dit qu'il fallait le lire, comme tu as lu fitzgerald (que j'adore) et Lawrence par pur suivisme deleuzien. Deleuze est grand, et Maël est son prophète...
Bien à toi,
THibaut
PS : Je me permets de te rappeler modestement que Delbos s'appelait Victor et non pas Vincent.
Et paf, ça c'est envoyé Gai Lulu! Bravo, alleluia, vive les Teletubbies, ils sont grands, et je suis leur prophétesse. Amen!
"le reste n'est que divagations"...
eh bien, laisse-moi divaguer. je préfère cela à la "richesse inouïe" (?) de la géométrie spinoziste.
Car là où tu parles de suivisme, je vois moi la richesse d'un auteur confrontant différentes pensées, lignes de fuite qui permettent en effet, une fois entamée la lecture de deleuze, de faire un certain chemin à travers spinoza ou lawrence. pas sûr que martial gueroult nous offre de telles possibilités, ni Victor "Vincent" Delbos.
Tu veux absolument m'associer à Deleuze. Il est vrai, comme tu as pu le constater, que j'ai une grande sympathie pour l'oeuvre et le personnage. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut inverser l'accusation d'obsession : si ma défense paraît si acharnée, c'est que chez toi le démontage de Deleuze est une rengaine tenace. Il y a comme une haine de la liberté deleuzienne, et de sa fécondité. Quoi, tu as lu Fitzgerald après les commentaires de Deleuze ? Quoi, tu as lu Spinoza par intérêt deleuzien ?
Mais que sais-tu de ce que j'ai retiré de Fitzgerald ? uniquement du deleuzianisme ? et de Spinoza ? juste une éthique du désir (ce qui serait déjà énorme...)?
Et avoir une certaine direction de lecture, je trouve ça assez rare. La direction n'étant pas "suivre Deleuze", mais avoir à l'esprit les problèmes de son oeuvre :qu'est ce qu'apprendre ? qu'est ce qu'un evenement ? alors Spinoza, apprendre à nager qu'est-ce que ce serait, Fitzgerald, qu'est ce que cette fêlure impersonnelle...
je préférerai donc volontiers ce "suivisme" des problèmes que la "richesse inouïe" du géométrisme spinoziste. c'est ça que tu kiffes, et je trouve ça, excuse-moi, très plat et un peu triste : le rationalisme pour lui-même, l'objectivité comme sainteté, la critique modeste comme credo.
ce qui fait que ton ironie à l'égard de mes positions, je la trouve toujours un peu scolaire, un peu déprimante. y a comme une passion de la dissertation chez toi, sur ton blog, sur ce blog, sur d'autres blogs de tes potes. c'est morose, vraiment.
l'ironie vengeresse de "agathe et ulrich" me laisse aussi songeur, surtout à cause de l'emprunt des noms de deux personnages aussi forts, surtout aussi à cause du patronage musilien de ce blog à forte tendance catholique... ce mixte pèse sur l'estomac.
enfin, je n'ai pas lu spinoza pour "sauver" deleuze, et pas que pour suivre ses problèmes. je l'ai lu aussi, et peut-être en grande partie, pour avoir un taf. ce qui est chose faite.
au plaisir de lire tes passions rationnelles, et autres compensations régressives sur le string.
Maël,
Cela vous étonne, qu'on puisse lire Musil et être catholique? Evidemment, la nuance n'est pas votre spécialité.
Puisque le mixte de mon blog vous pèse sur l'estomac, ne vous forcez pas, je vous en prie. Je serai ravie de ne plus y vous publier.
C'est vrai que vous apportez une touche de couleur à ce blog morose, où on ne parle que de choses plates et monotones, musiliennes et catholique, mais je crois que tous ici se passerons volontiers de votre gouaille. Mon blog est peut-être niais et indigeste, mais au moins, les gens s'y respectent et s'estiment.
Je préfère être passionnée par la dissertation que par la polémique. Car, à votre différence, je ne lis pas la philosophie pour en retirer une position sociale et un job(écrasante, comme vous nous le faites sentir de toute votre dédaigneuse hauteur). Je lis de la philosophie pour la vie de mon esprit.
Ah, la passion rationnelle, ah quel ridicule! Eh bien j'assume. Je continuerai à vous publier si votre propos a une teneur philosphique, sinon je vous laisse aller agresser Thibaut ailleurs, merci.
Maël,
je me doutais que ta réponse ne porterait plus sur Spinoza (et pour cause) mais régresserait vers la question du rationalisme.
Mais bon, aie un peu l'honnêteté d'admettre que ma vie ne consiste pas à taper sur deleuze ; j'y ai consacré un post, où je le critiquais sur deux points, et une partie dans un texte sur spinoza, où ma critique n'est pas spécialement virulente. Il se trouve que tu interviens systématiquement dès qu'apparaît le nom de deleuze légèrement critiqué. Je ne t'ai pas vu bondir sur Kant, où je ne cesse de citer avec force éloges les cours de Deleuze. Je n'ai pas cité différence et répétition quand j'évoquais hegel et derrida, et pourtant j'aurais pu... BOn,alors admets juste que l'on ne peut parler de lui avec distance sans que tu ne surgisses tel Philonenko défendant son Kant, tel Ramadan défendant son Prophète.
Ma passion de la dissertation me fait bien rire ; si je n'avais que ça comme défaut, je serais ravi ; mais rassure-toi, je n'ai pas de passion de la dissertation, j'ai même bien plutôt une incapacité totale à faire une dissertation normale.
Quant à la richesse inouïe du géométrisme, je conçois que tu ne puisses pas la concevoir ni l'admirer, que plus te plaisent les élucubrations contemporaines que la rigueur parfois abstraite (encore que la géométrie demeure très concrète) des maths, mais dans ce cas, pourquoi viens-tu parler de spinoza ? Ce qui est purement odieux dans le genre de démarches que tu suis, c'est le fait que, puisque la méthode ne te plait pas (ou n'est pas accessile à ton entendement), tu décides d'en faire abstraction et la déclares inepte, en disant que ceux qui respectent l'auteur spnt des rationalistes bornés. Tu t'écartes de la méthode par pure convenance personnelle, qui n'est que le masque d'une certaine imperméabilité de ta part à un géométrisme qui te dépasse, et tu maquilles ça du beau nom de "liberté". C'est trop facile mon ami. La liberté, rien que ça...
Bon allez, je m'en retourne à mes affaires de string, que tu qualifies de "compensation régressive", ce qui me fait rire aux éclats tant cela témoigne de ton fondamental manque d'humour. Enfin, j'appliquerai le principe de charité et supposerai que cette réplique est une façon de jouer le jeu du post. Enfin j'espère...
Ah, et oui, j'oubliais. Nous avons tous compris que tu étais sujet aux nausées (je compatis), que ta conscience morale t'occasionnait moult désagréments digestifs, du "burk, non mais burk quoi !" face à mes propos, à ce qui "pèse sur ton estomac" quand tu vois ceux d'Agathe. Je ne sais que te recommander, sinon peut-être une petite cure de Nietzsche, pour être enfin par-delà nos petites médiocrités qui te paraissent si méchantes, si peu morales, si choquantes pour les oreilles de ceux qui ont embrassé l'actuel et condamné la "régression".
Enregistrer un commentaire