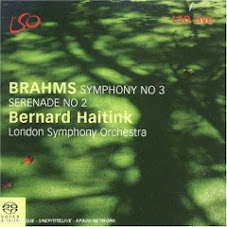Et enfin je termine en beauté là-bas...

Sur la corde raide de l'existence, jouer les funambules entre réel et possible, neurasthénie et sommeil de Dieu



Et enfin je termine en beauté là-bas...

Publié par
Sémiramis
à
13:08
15
commentaires
![]()
Libellés : Décadence

 Pour ceux qui voudraient se faire une idée sur un sujet aussi crucial grâce à d'autres avis que le mien propre, qui je l'avoue est un peu fétichiste, je renvoie à l'étude scientifique publiée par la revue d'investigations en féminologie Isa: "Mamies blouses", ce mois-ci: en kiosques.
Pour ceux qui voudraient se faire une idée sur un sujet aussi crucial grâce à d'autres avis que le mien propre, qui je l'avoue est un peu fétichiste, je renvoie à l'étude scientifique publiée par la revue d'investigations en féminologie Isa: "Mamies blouses", ce mois-ci: en kiosques.
Publié par
Sémiramis
à
22:02
17
commentaires
![]()
Libellés : Décadence
 La passion apparaît alors comme un jeu de forces vitales. Fondamentalement, la passion est un phénomène qui nous dépasse, qui transcende ce que l'on peut désigner simplement comme "sentiment" et même comme "affection": elle engage notre être entièrement, âme, corps et sensibilité. Dans tous les cas, la passion est une forme de consommation de notre être: elle nous brûle et nous oppresse, mais nous donne la certitude de notre unité, nous fait éprouver l'intensité et la grandeur de notre vie avec une acuité surprenante. Mais elle a un double visage. Elle peut nous rendre invinciblement forts et elle peut nous asservir et nous détruire.
La passion apparaît alors comme un jeu de forces vitales. Fondamentalement, la passion est un phénomène qui nous dépasse, qui transcende ce que l'on peut désigner simplement comme "sentiment" et même comme "affection": elle engage notre être entièrement, âme, corps et sensibilité. Dans tous les cas, la passion est une forme de consommation de notre être: elle nous brûle et nous oppresse, mais nous donne la certitude de notre unité, nous fait éprouver l'intensité et la grandeur de notre vie avec une acuité surprenante. Mais elle a un double visage. Elle peut nous rendre invinciblement forts et elle peut nous asservir et nous détruire."Le passionné de la vie n'est pas egocentré, comme le passionné de la mort qui n'arrive pas à sortir de son bourbier, bien au contraire ! Le passionné de la vie, celui qui lève les voiles dans la joie, brille, éblouit, y compris ceux qui n'ont rien demandé" (Commentaire de Jean-Baptiste Bourgoin)Celui qui lève le voile, qui brille: n'est-ce pas celui qui vit déjà sa résurrection? Profondément humaine, la passion ne nous apparaît donc plus comme un fléau, une façon dévoyée d'aimer - d'idolâtrer, mais comme une condition sine qua non pour vivre une vie digne d'être vécue. La condition humaine est appellée à la transfiguration dans la Gloire : la splendeur de cette vocation ne doit-elle pas susciter en nous cette passion pour la vie, qui nous rend plus forts, soutenus par la force de Dieu qui a ressuscité le Christ?
Publié par
Sémiramis
à
16:55
37
commentaires
![]()
Libellés : Ancien Testament, Anthropologie, Eros-Philia-Agapè, Evangile
Publié par
Sémiramis
à
22:25
21
commentaires
![]()
Libellés : Littérature
Publié par
Sémiramis
à
23:04
2
commentaires
![]()
Libellés : Littérature
J’ai découvert ces jours-ci, une nouvelle fois grâce à ma chère marraine, l’écrivain hongrois Sandor Maraï (1900-1989). Les braises : voici ce qui reste, au petit matin froid, de la généreuse flambée qui la veille animait le foyer. Les braises (1942) est un roman de la passion consumée.
« Si nous examinons notre propre cœur, qu’y trouvons-nous ? De la passion ! Il faut aussi que nous sachions que la vieillesse n’est jamais harmonieuse. Le temps peut affaiblir mais n’arrive jamais à étouffer les passions […] Elles n’ont, en effet, plus beaucoup de sens. Néanmoins, elles restent dans notre cœur. Pour quelle raison attendre autre chose du monde, de ce monde rempli de désirs inconscients, de passions et de violences ? […] Seules les passions vivent, nous brûlent et en appellent au ciel… » (p. 190-191)
La structure de l’œuvre est celle d’un huis clos entre deux vieillards à l’aube de la mort. Elle respecte scrupuleusement les cadres du théatre classique : unité de temps – une journée, prétexte à l’évocation de toute une vie, unité de lieu – une pièce qui porte en elle le souvenir d’un monde disparu, et d’un jour décisif entre tous. Structure théatrale qui semble faire écho à la vie intime du personnage du général, que l’auteur s’est choisi pour point de focalisation : ne soigne-t-il pas la mise en scène de la rencontre, comme s’il s’agissait ce soir-là de la dernière représentation sur la scène de son existence consumée ? A juste titre, le général se prépare à assister au dénouement de l’intrigue de sa propre vie, la dernière scène dont il a passé quarante ans à repasser les dialogues et les détails...
La maîtrise romanesque de Maraï est impressionnante. L’unité de temps et de lieu concentre et déploie effectivement une fresque d’une surprenante densité. Ce roman peu épais (220 pages) enferme l’évocation nostalgique d’un monde disparu, les rêves de puissance d’une Europe dont la grandeur s’efface dans les désillusions, qui rappelle Zweig (en mieux) et Musil (dans un autre genre !). Mais ces bribes de grand roman historique ne prennent leur sens que dans le face à face du général et de Conrad.
Le lecteur découvre peu à peu, au fur et à mesure du déroulement de la journée, la nature du drame qui s’est noué, il y a plus de quarante ans, entre les deux personnages – et dont je ne veux révéler précisément que les contours pour préserver le plaisir de la lecture. Au-delà du thème de la trahison, l’intrigue se noue autour de celui de la passion. L’amitié comme passion, qui recherche sa consommation dans l’autre, qui brûle et dévore de sentiments contradictoires, qui suffit à faire basculer l’existence d’un homme !
« - Avec l’âge, réplique le général, je pense que l’amitié pourrait bien être le sentiment le plus fort du monde… que c’est à cause de cela qu’elle est si rare. Et sur quoi repose-t-elle ? … Est-ce sur de la sympathie ? … Non, le mot est impropre. On ne peut pas dire par exemple que par pure « sympathie » deux personnes répondent l’une de l’autre dans les circonstances les plus critiques de la vie. Peut-être le fondement de l’amitié est-il différent ? …
- Mais que penses-tu donc ? demande Conrad. Dis-le une bonne fois.
Le général répond lentement, en cherchant ses mots.
- Peut-être au fond de tous les liens humains y a-t-il quelque chose du dieu de l’Amour,… d’Eros ? » (p. 102-103)
Mais finalement, derrière ce dénouement libérateur, ces mots sur l’amitié et la passion ne sont qu’une interrogation sur la capacité à vivre en vérité nos relations. Ne vivons-nous pas la vie comme une passion, une projection vers un autre que nous désirons ardemment et qui nous échappe ? Et peut-être nous échappe-t-il, parce que nous sommes incapable de le désirer pour ce qu’il est réellement, autrement que comme le support de nos fantasmes et de notre nostalgie.
« […] ce qui consistait la raison profonde de toutes mes actions a été le lien qui me rattachait à l’être qui m’a blessé, oui, c’étaient les liens qui me rattachaient aux deux êtres qui m’ont offensé. Accepter inconditionnellement certains liens, n’est-ce pas notre destinée ? […] Es-tu aussi d’avis que ce qui donne un sens à notre vie c’est uniquement la passion, qui s’empare un jour de notre corps et, quoi qu’il arrive entre-temps, le brûle jusqu’à la mort ? Crois-tu aussi que notre vie n’aura pas été inutile, si nous avons ressenti, l’un et l’autre, cette passion ? Peut-être la passion ne consiste-t-elle pas à désirer une certaine personne, mais à ressentir, en général, un désir nostalgique ? » (p. 217, c’est moi qui souligne)
Publié par
Sémiramis
à
13:39
28
commentaires
![]()
Libellés : Eros-Philia-Agapè, Littérature
A celui auquel on pensait, dont la voix nous enchante bien plus

 La zone de Cléry, au sud ouest d'Orléans, reste un site important de production de fruits (pommes, poires, cerises...) et de vins. Les vignerons de la région d'Orléans ont obtenu une AOC il y a pile un an, et je vous conseille ces petits vins bien sympathiques (cépage Cabernet): rouges légers, qui accompagnent très bien les repas entre amis sans façons.
La zone de Cléry, au sud ouest d'Orléans, reste un site important de production de fruits (pommes, poires, cerises...) et de vins. Les vignerons de la région d'Orléans ont obtenu une AOC il y a pile un an, et je vous conseille ces petits vins bien sympathiques (cépage Cabernet): rouges légers, qui accompagnent très bien les repas entre amis sans façons.
Publié par
Sémiramis
à
22:27
10
commentaires
![]()

"Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. Quoique vivants en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son oeuvre en nous, et la vie en vous"2 Corinthiens 4, 10-12
Publié par
Sémiramis
à
00:19
6
commentaires
![]()
Libellés : Hagiographie
 Il s'agit d'une étude sur Musil qui m'a enthousiasmée! A l'époque je réfléchissais effectivement sur le personnage de Jacob et sur le statut du couple des jumeaux dans cette histoire; ce qui m'avait naturellement amenée au couple Agathe Ulrich de l'oeuvre du grand autrichien.
Il s'agit d'une étude sur Musil qui m'a enthousiasmée! A l'époque je réfléchissais effectivement sur le personnage de Jacob et sur le statut du couple des jumeaux dans cette histoire; ce qui m'avait naturellement amenée au couple Agathe Ulrich de l'oeuvre du grand autrichien.
Robert Musil, mystique et réalité, l’énigme de l’« Homme sans qualités », par Paul Mommaers, Paris, éd. du Cerf, coll "Cerf Littérature", 2006, 202 p., 22 euros.
Publié par
Sémiramis
à
19:58
8
commentaires
![]()
Libellés : Musil, Ordre des Prêcheurs
Après la publication il y a bien des mois déjà, par Bruno, d’une passionnante série d’articles sur le concept du temps dans l’Etoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig, j’avais été amenée à réfléchir sur le concept du temps en christianisme. Aujourd’hui ce sont les réflexions de Jean-Baptiste Bourgoin et le débat suscité par Halio autour du texte d'Exode 3, 14 qui me ramènent à ce thème. Si Dieu est « je serai qui je serai », « celui qui suis », quel est le statut du temps en christianisme ?
Ce texte reprend donc le corps d'un commentaire que j'avais fait sur Systar et que je voulais réexploiter - mieux vaut tard que jamais n'est-ce pas? A cette fin, je me fais plaisir et exerce ma naturelle pédanterie avec ce titre improbable. "Circulinéarité et parousie": plus que d'effrayer le badaud (quoique...), il s'agit avant tout de montrer que la structure du temps, telle que je peux l'appréhender en christianisme, se construit sur un mode à la fois linéaire et cyclique, l'un ne pouvant être dissocié de l'autre. En cela je m'oppose à la conception du temps que Bruno décrivait chez Rosenzweig, où le temps chrétien "voie éternelle" se dissociait du temps juif "vie éternelle cyclique". Mais on ne peut parler du temps chrétien sans évoquer la fin qui lui est promise. Le temps chrétien ne tourne pas à vide: il va vers son aboutissement dans la "parousie", la fin des temps - moment de conclusion de l'histoire humaine et de "recréation" du monde.
On se retrouve donc devant une situation complexe en forme de tension qui correspond bien à la complexité de la foi catholique et à la dynamique interne du nom de Yahvé, plénitude de l'être en devenir:
- Un temps historique, linéaire, qui court vers son achèvement, lié à l'Incarnation, à la Passion, et à la Résurrection du Christ dans un premier temps, et à l'action de l'Esprit Saint dans un second. La caractéristique principale de cette dimension du temps est son irréversibilité. Tout acte posé dans ce temps qui se déroule est définitif et irrémédiable, et déclenche aussitôt un mécanisme de conséquences sur lesquelles on ne peut plus revenir.
- Un temps cyclique, liturgique, lié à la plénitude de Dieu qui est. Ici, on parle de temps liturgique au sens courant du terme: celui qui rythme la vie de l'Eglise selon une circularité symbolique, un système cyclique qui actualise l'histoire du salut en la redonnant à vivre de façon répétée et inlassable. En ce sens le temps dit "liturgique" peut être désigné comme "messianique" puisqu'il ordonne ces temps "qui sont les derniers" - c'est-à-dire les derniers avant la parousie. La vie du catholique est ordonnée selon une structure temporelle cyclique et répétitive qui l'inscrit personnellement dans l'histoire universelle du salut. Car la liturgie n'est que l'écrin des sacrements: on ne se situe donc pas uniquement sur un plan symbolique dans lequel on réévoquerait simplement l'histoire linéaire et ses évènements. Dans la dynamique sacramentelle, on vit réellement ce qui se joue et il faut croire que, de même que le pain devient réellement corps du Christ au moment de la consécration, l'évènement pascal est réellement une nouvelle création du monde, qui préfigure la recréation définitive lors de la fin des temps.
Ce qui s'est donc joué dans l'histoire linéaire, c'est-à-dire l'évènement de la résurrection du Christ, se rejoue dans la vie sacramentelle dans le baptême, et se renouvelle dans la circularité du temps liturgique qui donne à vivre la nuit pascale aux baptisés. Cette circularité liturgique, prise dans la linéarité du temps historique qui court vers son achèvement, préfigure la plénitude des temps dans le royaume de Dieu. Il y a tout lieu d'imaginer effectivement que la nouvelle création ne possèdera pas de structure spatio-temporelle... Par là, le temps chrétien suggère, et même donne à voir le dimanche de Pâques - le 8ème jour, l'éternité en germe et en "souffrance"au coeur même de l'histoire humaine qui en accouchera lors de la Parousie.
Mais cette double tension du temps est fondamentale dans le christianisme car elle renvoie également à la responsabilité de l'homme devant Dieu et à l'infinie miséricorde de ce dernier.
En ce sens, tout est pris dans le Logos. Le Christ est indépassable. Le temps naturel est le déploiement de sa présence au monde, Lui par qui tout a été fait. Dans cette dimension, l'homme est obligé de se soumettre au temps qui règle l'univers selon les lois que Dieu a voulues lors de la Création. Mais, dans le temps liturgique, c'est Dieu qui nous manifeste le fait qu'Il a voulu entrer dans cette soumission au temps. Puisque le Christ s'est incarné, Il a pris la dimension et la mesure de notre expérience du temps. D'où l'instauration d'un temps liturgique qui est le lieu où nous pouvons personnellement faire sa rencontre, selon les modalités de notre finitude. On ne peut donc penser le temps sans passer par l'Alpha et l'Oméga; il va jusqu'à notre histoire, tant universelle qu'individuelle, qui s'inscrive en Lui.
Publié par
Sémiramis
à
14:16
55
commentaires
![]()
Libellés : Ancien Testament, Evangile

Publié par
Sémiramis
à
23:50
8
commentaires
![]()
Libellés : Ancien Testament, Invités
Exode 3, 14 (traduction Bible de Jérusalem)

Publié par
Sémiramis
à
20:02
9
commentaires
![]()
Libellés : Ancien Testament
 Alors qu'en est-il? Une révolution dans la relation entre moi et mes lèvres. Voila, je me suis acheté le baume prodigieux pour les lèvres de Nuxe et c'est vraiment top. Complètement exaltant parce qu'on a en même temps l'effet GLOSS (couleur chocolat irisé pour moi, rien que ça eh eh eh) et le soin des lèvres, puisque ce baume est nourrissant et protecteur! En plus il sent vraiment super bon - comme tous les produits de cette marque d'ailleurs. Et on peut se la jouer Audrey Hepburn avec son lipstick, dans les toilettes au boulot!
Alors qu'en est-il? Une révolution dans la relation entre moi et mes lèvres. Voila, je me suis acheté le baume prodigieux pour les lèvres de Nuxe et c'est vraiment top. Complètement exaltant parce qu'on a en même temps l'effet GLOSS (couleur chocolat irisé pour moi, rien que ça eh eh eh) et le soin des lèvres, puisque ce baume est nourrissant et protecteur! En plus il sent vraiment super bon - comme tous les produits de cette marque d'ailleurs. Et on peut se la jouer Audrey Hepburn avec son lipstick, dans les toilettes au boulot!
Publié par
Sémiramis
à
22:38
31
commentaires
![]()
Libellés : Décadence






 Pâquerettes, Roger et Gallet, conçu entre 1910 et 1920.
Pâquerettes, Roger et Gallet, conçu entre 1910 et 1920. L'inspiration généreuse de Lalique se manifeste pleinement dans cet élégant flacon reprennant le motif de... trois guêpes!
L'inspiration généreuse de Lalique se manifeste pleinement dans cet élégant flacon reprennant le motif de... trois guêpes! Même inspiration pour Au coeur des calices, conçu pour René Coty. Le flacon représente le calice de la fleur, et le bouchon, un petit bourdon...
Même inspiration pour Au coeur des calices, conçu pour René Coty. Le flacon représente le calice de la fleur, et le bouchon, un petit bourdon...
Publié par
Sémiramis
à
14:02
11
commentaires
![]()
Publié par
Sémiramis
à
09:45
2
commentaires
![]()