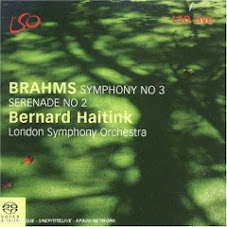Il est temps de parler enfin de choses un peu intelligentes sur ces pages, sous peine terminer l'année sur des futilités innocentes. Je tente donc une audacieuse réflexion rapprochant les deux romans dernièrement lus et aimés, rapprochement qui pourra sembler improbable tant Antoine Bloyé et son auteur révolté Paul Nizan ont peu à voir avec l'aristocrate désabusé Tomasi di Lampedusa, père du Guépard.
Improbable, certainement; malgré tout ces deux livres ont le trait commun de mettre en scène des hommes en prise avec leur classe sociale, qui subissent à la fois le poids du passé et les bouleversements d'un monde en pleine mutation. Personnages qui peuvent nous aider à réfléchir sur l'identification d'un individu à sa classe. Entre le prince Fabrizio, l'aristocrate qui constate avec lucidité la décadence de sa lignée et du monde qui l'a portée, et l'ingénieur embourgeoisé, Antoine, arraché à la condition ouvrière par un ascenseur social plus subi que choisi, le jeu de miroir est troublant.
 Les deux livres se prêtent à cet exercice, étant axés sur la vie de leur personnage principal qui est aussi le point de focalisation de la narration - et qui porte le titre de l'ouvrage. Ils déploient le même cadre historique, celui d'une montée en puissance de la bourgeoisie, incarnée par le personnage de don Calogero dans le Guépard, qui se manifeste pleinement lors d'une scène théatrale:
Les deux livres se prêtent à cet exercice, étant axés sur la vie de leur personnage principal qui est aussi le point de focalisation de la narration - et qui porte le titre de l'ouvrage. Ils déploient le même cadre historique, celui d'une montée en puissance de la bourgeoisie, incarnée par le personnage de don Calogero dans le Guépard, qui se manifeste pleinement lors d'une scène théatrale:"Le Prince avait toujours tenu à ce que le premier dîner à Donnafugata [son fief] eût un caractère solennel [...] Il ne transigeait que sur un détail: il ne mettait pas d'habit de soirée pour ne pas embarrasser ses hôtes qui, évidemment, n'en possédaient pas. Ce soir-là, dans le salon dit "de Leopoldo", la famille Salina attendait les derniers invités [...] Tout était paisible et comme à l'accoutumée, lorsque Francesco Paolo, le fils de 16 ans, fit une irruption scandaleuse dans le salon: "Papa, don Calogero est en train de monter l'escalier. Il est en frac!"L'écroulement du monde du Prince, politiquement marqué par le fameux débarquement de Garibaldi sur les côtes siciliennes, s'incarne dans ce parvenu ridicule - à la fille duquel il mariera pourtant son neveu chéri, Tancredi au nom si héroïque! La saveur inimitable de cette description tient peut-être à l'amertume explicite de Lampedusa, l'aristocrate, devant l'accession au pouvoir, par le biais de la république, d'une classe aussi piètrement symbolisée. Le Guépard est l'héritier d'une lignée, d'un monde qui vont disparaître avec lui: et il n'en est que trop conscient. Le Prince, relayé par le narrateur, contemple avec un regard féroce les filles de l'aristocratie sicilienne, écrasées par la beauté d'Angelica, la fille de don Calogero, fiancée de Tancredi:
Tancredi évalua l'importance de la nouvelle une seconde avant les autres; il était occupé à ensorceler la femme de don Onofrio, mais quand il entendit le mot fatal, il ne put se retenir et éclata d'un rire convulsif. Le Prince au contraire ne rit pas, lui à qui, il faut le dire, la nouvelle fit plus d'effet que le bulletin du débarquement à Marsala. Ce dernier avait été non seulement un évènement prévu, mais aussi lointain et invisible. A présent, sensible comme il l'était aux présages et aux symboles, il contemplait la Révolution en personne dans ce noeud papillon et cette queue-de-pie noire qui montaient l'escalier de sa maison. Non seulement, lui, le Prince, avait cessé d'être le plus grand propriétaire de Donnafugata, mais il se voyait aussi contraint de reçevoir en costume d'après-midi un invité qui se présentait, à bon droit, en habit de soirée.
Son abattement fut grand et durait encore tandis qu'il avançait mécaniquement vers la porte pour reçevoir l'invité. Mais quand il le vit, ses souffrances furent plutôt allégées. Parfaitement adéquat en tant que manifestation politique, on pouvait cependant affirmer que, quand à la réussite de sa confection, le frac de don Calogero était une catastrophe. Le tissu était très fin, le modèle récent, mais la coupe était tout simplement monstrueuse. Le Verbe londonien s'était très maladroitement incarné en un artisan de Girgenti auquel l'avarice tenace de don Calogero s'était adressée. Les pointes des deux pans se relevaient vers le ciel en une supplication muette, le grand col était informe et, quoique ce soit pénible, il faut bien le dire, les pieds du maire étaient chaussés de petites bottes à boutons."Le Guépard, II, p. 80-81 (c'est moi qui souligne)
"Mais les autres... heureusement que des tenèbres de Donnafugata avait émergé Angelica pour montrer aux Palermitaines ce qu'était une belle femme.Il y a quelque chose de morbide dans cette classe décadente, que la vitalité sans scrupules et sans éducation d'Angelica vient balayer d'un revers de main gantée. Mais il faut absolument lire le dernier chapitre du roman pour lire l'histoire des propres filles du Prince...
On ne pouvait pas lui donner tort: dans ces années-là, la fréquence des mariages entre cousins, dictés par la paresse sexuelle et les calculs terriens, la rareté de protéines dans l'alimentation aggravée par l'abondance d'amidon, le manque total d'air frais et de mouvement, avaient remplis les salons d'une foule de jeunes filles incroyablement petites, invraisemblablement olivâtres, insupportablement gazouillantes; elles passaient leur temps coagulées entre elles, ne lançant des appels en choeur aux jeunes hommes apeurés, destinées, semblait-il, à ne servir que de toiles de fond aux trois ou quatre belles créatures qui [...] passaient en glissant comme des cygnes sur un étang rempli de grenouilles. Plus il les voyait plus il se sentait irrité; son esprit habitué aux longues solitudes et aux pensées abstraites finit par lui procurer, à un moment donné, une sorte d'hallucination alors qu'il traversait une longue galerie en passant devant un pouf* central où s'était rassemblée une colonie de ces créatures: il lui semblait être le gardien d'un jardin zoologique en train de surveiller une centaine de jeunes guenons: il s'attendait à les voir tout d'un coup grimper aux lustres, et là, suspendues par la queue, ses balancer en exhibant leur derrière et en lançant des coquilles de noisettes, des cris et des grincements de dents sur les pacifiques visiteurs.
Etrangement, ce fut une sensation religieuse qui le détourna de sa vision zoologique: en effet, de ce groupe de guenons en crinolines, s'élevait, monotone et continue, une invocation sacrée: "Marie! Marie!", s'exclamaient perpétuellement ces pauvres filles [...] Le nom de la Vierge, invoqué par ce choeur virginal, remplissait la galerie et changeait de nouveau les guenons en femmes, parce qu'il ne semblait pas encore que les ouistitis* des forêts brésiliennes se soient converties au Catholicisime"Le Guépard, VI, p. 234-235 (c'est moi qui souligne)

"Tout encourageait alors la jeunesse ouvrière, les descendants ambitieux des artisans, des petits fonctionnaires, à entrer dans le complot du commandement; Antoine y avait été entraîné comme les autres et il ignorait tout des ressorts qui tendaient cette grande entreprise, il ne savait pas qu'il faisait avec bien d'autres adolescents de son âge un des enjeux de la vaste partie que commençaient à engager les principaux maîtres de la bourgeoisie française. On lui avait dit simplement qu'il pourrait échapper à la misère, aux incertitudes ouvrières, et ces promesses avaient trop bien répondu aux tentations que sa ville lui offrait pour qu'il se refusât à les entendre. Il ne savait rien"Parvenu, Antoine Bloyé ne parvient pas à surmonter la contradiction interne qui l'habite entre la conscience d'une trahison envers sa classe et l'impossibilité de se reconnaître dans la bourgeoisie:Antoine Bloyé, V, p. 68 (c'est moi qui souligne)
"C'étaient des hommes prêts à tuer des ouvriers. Antoine les détestait, mais il leur donnait des conseils pour briser sans violences la grève des ouvriers. Je suis mon propre ennemi, se disait-il. Cette division de lui-même, ce déchirement de sa vie, cet abîme qui séparait sa jeunesse de son âge mûr, ce malheur éclataient dans ces conciliabules avec les policiers"A l'inverse de Fabrizio Salina, trop enraciné, chargé de trop d'histoire, Antoine est un déraciné, symbolisant la construction d'une civilisation qui se coupe de ses racines pour monter en puissance plus vite - trop vite. Quand la famille Salina est encombrée d'un chateau absurde dont on ne connaît même pas toutes les pièces, comme d'une histoire dont le contenu ne signifie plus rien, Antoine est expulsé de son monde familial par son ascension sociale, qu'il n'a finalement pas désirée:Antoine Bloyé, XIV, p. 208 (c'est moi qui souligne)
"Toutes les possessions terrestres des Bloyé auraient tenu sur une charrette à bras:Il s'agit pour nous d'assumer cet "héritage précédé d'aucun testament", car, d'un monde à l'autre, entre décadence et déracinement, c'est à la naissance de notre propre civilisation, républicaine et démocratique, technicienne et aculturée, que nous sommes conviés.
"C'est bien assez bon pour des vieux comme nous", disaient-ils.
A mesure qu'ils vieillissaient, les surface de leur vie diminuait encore, cette vie qui avait toujours été si mince, si peu importante, qui avait éveillé si peu d'échos, touché de ses ondes si peu d'êtres [...] Tous les ans, trois ou quatre jours par an, Antoine retrouvait les meubles, les fantômes des mouvements, les vestiges des pas de son enfance [...] Il songeait qu'on ne vit guère avec les gens qu'on aime, trois jours, quatre jours par ans, quelle dérision! Il leur demandait de venir passer l'hiver chez lui, mais ils refusaient, ils disaient:
"Nous vous gênerions..."
Car ils avaient pris l'habitude de vivre avec un fils imaginaire qui leur semblait trop haut placé pour eux. Les souvenirs d'enfance, les nouvelles du village épuisées, ils n'avaient pas grand-chose à lui dire. Ils étaient chacun dans un monde"Antoine Bloyé, XVIII, p. 256 (c'est moi qui souligne)